Interviews
Serge Poisson-de Haro et les enjeux stratégiques des organisations artistiques

Serge Poisson-de Haro est professeur agrégé au département du management à HEC Montréal.
Expertises
Stratégie, capacités dynamiques, gestion des arts, organisation et environnement naturel, gestion des organisations artistiques.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Serge Poisson-de Haro : Premièrement, ce qui m’intéresse ce sont les enjeux de gestion et les enjeux stratégiques des organisations artistiques. Je suis professeur de stratégie et j’étudie depuis plusieurs années les organisations artistiques montréalaises, telles que le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’Art Contemporain, l’Opéra de Montréal, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain, le Festival Montréal en lumière et les cirques tels le Cirque Éloize, le Festival Montréal Complètement Cirque, etc. En tant que professeur de stratégie, j’analyse leurs divers enjeux et je tente d’appliquer des modèles d’analyse stratégique classique pour conduire des analyses de leurs contextes, interne comme externe. La théorie des ressources en est un. À l’interne, j’analyse les ressources et les compétences dont dispose la compagnie pour évaluer celles qui permettraient de développer un avantage concurrentiel. Également, le concept de modèle d’affaire, une littérature stratégique émergente depuis plusieurs années, permet de définir sa proposition de valeur et comment s’organiser à l’interne pour livrer le service au client cible. Le tout requiert de bien comprendre le positionnement stratégique d’une organisation au sein de son environnement externe, tant concurrentiel qu’au sens plus large. Ce sont tous ces éléments que je tente de prendre en considération dans une analyse stratégique.
Deuxièmement, j’aime beaucoup la pédagogie et les méthodes expérientielles pour enseigner la gestion stratégique. Je favorise méthode des cas ou encore l’utilisation de simulation informatique répliquant les dynamiques concurrentielles au sein d’un secteur donné. 90% de mon enseignement est expérientiel. Je fais très peu de cours magistraux, car je préfère lorsque l’étudiant est acteur de la situation et des analyses à faire pour trouver les solutions aux enjeux de gestion. Une partie de ma recherche est d’ailleurs dédiée à la pédagogie.
C’est par le biais de la pédagogie que je me suis penché sur l’analyse stratégique des organisations culturelles. Cela correspondait à ma volonté de comprendre les spécificités du tissu culturel à Montréal à mon arrivée dans la métropole. C’est la rédaction de cas sur des organisations locales de renom qui m’a mené à lancer le projet de recherche : « Les Enjeux de gestion au XXIème siècle ». Cette recherche m’a permis, par exemple, de largement analyser les enjeux de gestion vécus par le Musée des beaux-arts de Montréal. J’ai relevé comment, par un meilleur ancrage local, le musée a pu rayonner à l’international. De par ses stratégies, ses choix de mieux s’ancrer localement, de s’appuyer sur des compétences locales et de créer des expositions temporaires qui ensuite voyagent à travers le monde, le MBAM est devenu le premier musée au Canada, avec plus d’un million de visiteurs par année. Une exposition comme celle de Jean-Paul Gauthier, entièrement créé au Québec avec des compétences locales, fait actuellement le tour du monde et favorise le rayonnement international du musée. C’est important localement pour encourager la communauté montréalaise de soutenir son musée pour assurer son succès ici et ailleurs.
Finalement, on peut dire que le nerf de la guerre, comme pour toute organisation, c’est d’assurer l’équilibre financier tout en étant fidèle à sa mission. Les enjeux des organisations artistiques se situent grandement au niveau du financement. On parle généralement d’organisation sans but lucratif. Ces organisations sont davantage financées par des fonds publics (trois paliers de gouvernement), des donateurs privés, des commandites mais aussi par la capacité de l’organisation à générer des revenus autonomes comme les recettes de billetterie. L’équilibre financier est certainement un des enjeux majeurs des organisations artistiques et celui-ci passe par la fidélisation et le renouvellement du public. L’objectif est de renouveler l’offre et ainsi attirer une nouvelle clientèle, tout en restant fidèle à la ligne directrice artistique. L’optimisation organisationnelle de chaque dollar dépensé est centrale. L’objectif est d’être en mesure de faire plus avec moins. Dans les organisations artistiques, on est loin de la quête de profit, on aspire avant tout à faire vivre la mission artistique. Par ailleurs, il est important de changer la perception commune du grand public, à savoir que la culture se doit d’être gratuite. Cette perception est grandement alimentée par les nombreux festivals culturels gratuits, mais cette même perception distancie le grand public des enjeux de financements vécus par les organisations artistiques.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Serge Poisson-de Haro : Le défi est d’innover et d’être ancré dans les défis quotidiens de ces organisations. Comment les outils développés dans le milieu des affaires peuvent-ils être pertinents au secteur des arts, comment adapter l’existant? L’enjeu est aussi de trouver quelque chose de nouveau en termes de gestion, qui serait issu de la complexité du secteur des arts. On pourrait exporter certaines pratiques vers le monde de l’entreprise, pour que celui-ci puisse apprendre du secteur des arts. Le défi est de faire une sorte de boucle entre les deux. Comme l’équation financière des organisations artistiques est particulière, elle implique une gestion plus complexe avec les parties prenantes. Ces organisations doivent aller chercher des dons, des subventions gouvernementales et gérer les attentes d’un plus grand nombre de parties prenantes, comparativement à la plupart des entreprises qui se soucient prioritairement des attentes des clients et des actionnaires. Les entreprises peuvent apprendre à mieux s’intégrer dans leurs communautés en observant ce que font les organisations artistiques. La polyvalence, la capacité à faire plus avec moins et cette gestion complexe des parties prenantes sont les connaissances clés en gestion des organisations artistiques. Et elles sont valides pour des organisations autres qu’artistiques.
Je me dis souvent que ce qui différencie probablement le secteur des arts du monde de l’entreprise, c’est qu’il donne avant tout des émotions. Beaucoup d’entreprises ont du mal à trouver le sens de l’émotion spontanée. Je crois que les rêves véhiculés par l’art sont ce qui nous rend humains. Ce sont ces souvenirs qui nous restent et nous rendent heureux, beaucoup plus que nos possessions matérielles qui se périment par obsolescence programmée. Je crois qu’il est important que ces organisations qui donnent des émotions restent pérennes, car elles créent des instants de vie dont on se souvient longtemps. Elles permettent même parfois de transcender le quotidien.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Serge Poisson-de Haro : L’intégration du développement durable comme source d’avantage concurrentiel pour les compagnies fut ma thèse universitaire. C’est un peu une thèse pour « sauver le monde ou rendre le monde meilleur » en voulant encourager les entreprises à contribuer au système économique tout en ayant un impact social et environnemental positif. C’est ce côté un peu idéaliste que j’ai, mais aussi par intérêt personnel que je me suis tourné vers le milieu artistique. Un monde sans artistes serait triste, mais ceux-ci ont généralement besoin de renforcer leurs compétences de gestion. C’est cet aspect qui a en quelque sorte démarré mon intérêt pour les organisations artistiques. Étant un Canadien adoptif (d’origine française), cette passion pour les arts, mon penchant pour la stratégie en général et pour les stratégies des organisations artistiques en particulier m’ont, en quelque sorte, permis d’apprendre et de mieux m’intégrer à l’écosystème montréalais, notamment culturel.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Serge Poisson-de Haro : Il est important d’écouter les praticiens et de comprendre leurs difficultés quotidiennes. Il faut se mettre au service de leurs problèmes très concrets avec une rationalité et une rigueur académique, pour tenter de trouver une interprétation possible à ce qui se passe et éventuellement trouver des solutions. Il faut démarrer sur le terrain, connaitre les théories et qu’elles soient au service de l’explication du sujet observé. C’est grâce au lien entre ces théories académiques et les situations concrètes qu’émergent souvent des solutions durables. Il est important de rester collé à la réalité tout en prenant du recul pour l’analyse. C’est en faisant des ponts entre l’observation et la théorie qu’on peut créer de nouvelles théories et de nouvelles solutions.
Serge Poisson-de Haro chez eValorix
Texte par Fanny Vadnais
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Sylvain Sénécal et le consommateur moderne

Sylvain Sénécal est professeur titulaire au service de l’enseignement du marketing à HEC Montréal. Il est également titulaire de la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier, co-directeur du Tech3Lab et président de imarklab.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Sylvain Sénécal : Je suis titulaire de la Chaire de commerce électronique RBC Groupe Financier et codirecteur du Tech3Lab à HEC Montréal. La chaire s’intéresse à l’utilisation de la technologie dans le quotidien des consommateurs québécois et canadiens, notamment pour combler leurs besoins de consommation. Cette technologie peut être l’ordinateur de bureau, la tablette, le téléphone intelligent ou une interface en magasins. Nous publions le fruit de notre recherche sous forme d’articles scientifiques et cela peut aussi donner lieu à des études de cas ou des livres blancs « whitepapers » lorsque l’on collabore avec des entreprises.
Le Tech³Lab se spécialise en expérience utilisateur, à la chaire on se spécialise en marketing électronique. L’idée du Tech³Lab c’est d’avoir un endroit où l’on peut observer de façon très précise, avec des méthodologies variées, une interaction entre une personne et une interface. On utilise beaucoup l’oculométrie, des mesures physiologiques comme le rythme cardiaque ou la sudation, ou même la reconnaissance faciale des émotions et l’électroencéphalographie (voir quelle région du cerveau est activée durant une tâche). L’idée c’est d’analyser l’interaction sans déranger l’utilisateur.
Nous essayons de mieux comprendre comment les consommateurs vivent leur expérience en ligne. On s’intéresse beaucoup à la prise de décision. Elle peut se traduire notamment par la recherche d’un produit, le fait de s’informer sur un produit ou service, acheter sur un site web ou encore la rétroaction sur les médias sociaux. Ce grand cycle de prise de décision, c’est important de bien le comprendre afin d’offrir aux consommateurs des services en ligne qui répondent bien à leurs besoins et facilitent leur vie.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Sylvain Sénécal : Le défi c’est d’observer et de comprendre l’interaction sans nuire à celle-ci. Quand on pose des questions, il est possible que la personne ne se rappelle pas de la première minute de son interaction ou qu’elle effectue une interprétation moyenne de son interaction globale. L’idée de l’instrumentation que l’on utilise pour analyser est d’aller chercher des observations durant l’interaction.
Quelqu’un qui ne réussit pas son achat va peut-être évaluer négativement tous les aspects d’une interaction, alors que la frustration est causée par un élément précis. On peut voir que l’émotion négative est arrivée à un moment donné et ainsi ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Sylvain Sénécal : À la base je me suis toujours intéressé au comportement du consommateur, puis, durant ma formation universitaire, les technologies sont apparues de plus en plus dans la vie du consommateur (sites web, appareils mobiles, etc.). J’ai effectué mon doctorat au sommet de la bulle internet. Cet intérêt pour comprendre le consommateur et son interaction avec la technologie nous a amenés graduellement à voir comment des outils utilisés au Tech³Lab peuvent nous aider à avoir une meilleure compréhension de ces interactions.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Sylvain Sénécal : Dorénavant, la présence sur internet est de mise pour n’importe quelle entreprise, de n’importe quelle taille et de n’importe quelle industrie. Si tu n’es pas sur internet, tu n’existes pas pour un consommateur : il débute sa recherche en ligne.
À la base, l’entreprise doit bien connaître les besoins de sa clientèle et refléter cette compréhension sur sa présence en ligne. Si une entreprise mise beaucoup sur le service à la clientèle, il faut que l’image en ligne soit cohérente avec cela. Le positionnement dans les différents points de contacts (canaux) est le cœur d’une expérience client réussie.
Pour les chercheurs c’est un domaine très stimulant, à la fine pointe de la technologie. Ainsi, pour effectuer de la recherche dans ce domaine, il faut une bonne compréhension des consommateurs, de la technologie, des outils d’observation des comportements en ligne et finalement, de l’analyse de ces données.
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Vincent Fourmond et le métabolisme énergétique
 Vincent Fourmond est chargé de recherche/research associate au laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP) UMR7281, une Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille (AMU). La commercialisation de son outil QSoas est rendue disponible par la SATT Sud-Est.
Vincent Fourmond est chargé de recherche/research associate au laboratoire de Bioénergétique et Ingénierie des Protéines (BIP) UMR7281, une Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’Université d’Aix-Marseille (AMU). La commercialisation de son outil QSoas est rendue disponible par la SATT Sud-Est.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Vincent Fourmond : Je suis électro-chimiste, je cherche à comprendre les enzymes qui sont impliqués dans la respiration de certaines bactéries. Notre travail s’inscrit dans la recherche fondamentale et a trait au domaine du stockage et de la conversion de l’énergie. Le logiciel que j’ai créé, QSoas, nous sert à analyser l’activité électrochimique.
Il y a des applications pratiques à cette recherche aussi. Par exemple, les hydrogénases sont des excellents catalyseurs pour produire de l’hydrogène ou l’oxyder. On peut s’imaginer utiliser ces enzymes dans les piles à combustible afin de générer de l’électricité par exemple (création d’énergie via réaction chimique) ou concevoir des catalyseurs pour produire de l’hydrogène et l’utiliser pour notamment remplacer le platine, coûteux et rare. Nous travaillons aussi sur des enzymes dans le stockage du CO2. Être capable de fabriquer du carburant à partir du gaz carbonique, c’est un des plus gros défis du secteur de l’énergie – du moins dans la partie chimique.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Vincent Fourmond : Le vrai problème dans le domaine de l’énergie en ce moment c’est le stockage. L’énergie solaire est abondante, mais elle n’est pas toujours présente (plus faible en certaines saisons ou absente la nuit). Il faut pouvoir stocker cette énergie et éventuellement la transporter. L’électricité est dure à stocker, mais on devrait pouvoir conserver l’énergie sous forme chimique – une des stratégies c’est de fabriquer de l’hydrogène.
Une autre approche est aussi d’utiliser l’énergie afin de fabriquer du carburant à partir du CO2 dans l’atmosphère. Présentement, c’est techniquement possible, mais le rendement énergétique global est encore trop faible pour que ce soit viable.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Vincent Fourmond : Je suis physicien à la base, l’énergie et la biologie m’ont séduit. Pour moi, c’est fascinant de voir comment les êtres vivants sont capables d’extraire l’énergie de leur environnement – la bioénergétique. Comprendre comment tout ça fonctionne au niveau moléculaire ou de la bactérie. Les enzymes sur lesquelles on travaille s’inscrivent dans le métabolisme énergétique, elles participent à la vie de la bactérie. Elles auraient été présentes dès l’origine de la vie, dans des sources chaudes abondantes en hydrogène. Essayer de les comprendre et voir comment elles ont émergé permet d’avoir des pistes sur les conditions de ces origines.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Vincent Fourmond : Le domaine le plus intéressant et le plus dur en ce moment est du côté biologique de la réduction du CO2. Les enzymes sont très difficiles à étudier et on a peu de résultats jusqu’à présent. D’après moi, il y a beaucoup à apprendre de ces enzymes. Ce sera un travail collaboratif d’une équipe multidisciplinaire. Les sujets que l’on aborde sont trop vastes pour être abordés par un seul spécialiste, il faut apprendre à communiquer avec le langage issu du champ d’expertise de nos collègues.
Notre recherche est une belle collaboration avec des physiciens qui ont des approches en spectroscopie ou des chimistes-théoriciens qui essaient de calculer les états chimiques qui peuvent être impliqués dans la catalyse. On travaille aussi avec des gens qui font de la cristallographie (pour déterminer la structure de protéines, comment s’organisent les atomes de protéines) et avec des chimistes plus intéressés par l’applicatif – par exemple créer des électrodes pour faire des piles à combustible.
Vincent Fourmond chez eValorix
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Marie-Christine Ouellet et la santé psychologique après un traumatisme craniocérébral
 Marie-Christine Ouellet est professeure agrégée à l’École de psychologie de l’Université Laval. Elle est également chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
Marie-Christine Ouellet est professeure agrégée à l’École de psychologie de l’Université Laval. Elle est également chercheuse au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS).
Expertises
Psychologie clinique de la santé et psychologie de la réadaptation. Psychopathologie associée aux troubles neurologiques et aux blessures traumatiques (particulièrement les traumatismes craniocérébraux) chez les adultes et les aînés. Adaptation des méthodes d’évaluation et d’intervention cognitivo comportementale à des populations en réadaptation.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Marie-Christine Ouellet : Ce qui m’intéresse le plus, ce sont les difficultés rencontrées sur le plan de la santé psychologique après un traumatisme craniocérébral. Ça couvre un spectre assez large : ça peut se présenter sous forme de dépression, d’anxiété, d’insomnie, une fatigue qui s’installe et devient chronique, la consommation de substances, etc. Nous nous intéressons à tout le spectre de sévérité, allant de la commotion simple à un traumatisme beaucoup plus sévère et qui peut avoir des impacts à des niveaux cognitifs, physiques, comportementaux ou émotionnels.
Ce n’est pas parce que l’atteinte est légère que tout va bien aller ou que parce que l’atteinte est sévère que tout va mal. Malheureusement les problèmes de santé mentale sont très fréquents suite à un traumatisme crânien, mais ils manquent encore d’attention scientifique. Beaucoup d’efforts sont mis pour sauver la vie des individus subissant un choc à la tête et aussi afin leur offrir une réadaptation (surtout physique et cognitive). Toutefois, ces efforts peuvent être compromis si ces gens voient leur santé mentale affectée sans être traités.
On ne sait pas ce qui est attendu ou normal par rapport à un tel évènement. Le traumatisme craniocérébral est une condition chronique, on vit avec les conséquences toute sa vie. C’est probablement difficile pour la personne et le clinicien de distinguer ce qui est attendu de ce qui est pathologique. Les gens ne vont pas nécessairement chercher de l’aide. Il faut rendre les interventions plus accessibles, disséminer des interventions comme par exemple des thérapies cognitivo-comportementales.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Marie-Christine Ouellet : Ce n’est pas évident de distinguer ce qui était une problématique présente avant l’accident, de ce qui l’est après, ou encore ce qui fait partie du cours normal de la vie de l’individu. Ce qui est très clair c’est que la prévalence des problèmes de santé mentale est extrêmement grande chez les individus qui ont subi un traumatisme crânien par rapport à la population générale. Il n’y a pas assez de traitement et de prévention qui sont faits. Il faudrait développer des interventions préventives pour que les gens aient la meilleure qualité de vie possible après un accident. On pourrait possiblement prévenir la dépression, l’insomnie, le recours à l’utilisation de substances, etc. On peut faire du travail auprès de cliniciens, mais il faudrait qu’il y ait des programmes diffusés au grand public. Les gens ne savent pas pour la plupart qu’ils sont plus à risque de problèmes de santé mentale suite à un accident. Près de la moitié des gens qui subissent un traumatisme crânien vont développer une condition cliniquement significative.
Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet?
Marie-Christine Ouellet : J’ai débuté ma formation en neuropsychologie. On s’intéressait plus aux aspects cognitifs : mémoire, attention, etc. Dans le cadre de mes contacts cliniques, je me suis intéressée aux aspects émotionnels; faire du suivi sur des conséquences émotionnelles de conditions neurologiques. Des gens dont les séquelles au plan neuropsychologique ont des impacts sur leur couple, leur famille et leur état d’esprit. On est un peu au confluent de la neuropsychologie, de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique. Ça s’appelle de la psychologie de la réadaptation.
J’ai des collaborations avec des médecins d’urgence, des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, des travailleurs sociaux, des gens en épidémiologie. Pas juste des chercheurs, mais des cliniciens aussi.
Dans le cadre de notre projet, on suit environ 400 personnes. L’objectif est d’avoir des applications pratiques tirées de nos conclusions. Nous nous intéresserons de plus en plus aux aînés également. Avec le vieillissement de la population, plus les gens demeurent actifs longtemps, plus on augmente le risque de chute. Le virage de la recherche dans les traumatismes crâniens au niveau de cette population n’est pas vraiment amorcé. On prend toutes les problématiques associées au vieillissement et on superpose les problèmes cognitifs suite à un traumatisme crânien. Ce projet avec les aînés est vraiment une initiative des cliniciens et que je supporte.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Marie-Christine Ouellet : Ce qui est motivant, c’est l’idée de pouvoir faire une différence dans la qualité de vie des patients. La population de gens qui subit des traumatismes craniocérébraux est en fait très nombreuse, donc la recherche dans ce domaine aura potentiellement des impacts importants sur bien des gens. Par contre, c’est souvent une blessure invisible, il y a donc encore beaucoup de travail à faire pour que la société reconnaisse les maux issus de ces traumatismes.
Marie-Christine Ouellet chez eValorix
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
Capsule FRQS sur le manuel INSOMNIE ET FATIGUE APRÈS UN TRAUMATISME CRANIOCÉRÉBRAL
Martin Beaulieu et la logistique hospitalière
 Martin Beaulieu est professionnel de recherche à HEC Montréal et membre du groupe de recherche CHAÎNE. Il est également chargé de cours à HEC Montréal et à l’Université de Montréal au département de l’administration de la santé.
Martin Beaulieu est professionnel de recherche à HEC Montréal et membre du groupe de recherche CHAÎNE. Il est également chargé de cours à HEC Montréal et à l’Université de Montréal au département de l’administration de la santé.
Expertises
Stratégie des groupes d’achats du secteur de la santé, modes de réapprovisionnement des unités de soins, diagnostic logistique d’établissement de santé.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Martin Beaulieu : Mes intérêts de recherche portent sur la logistique hospitalière; tout le volet de l’approvisionnement et de la gestion des stocks dans le réseau de la santé. Ça peut être aussi les relations externes avec les fournisseurs, mais principalement tout ce qui se déplace à l’intérieur de l’établissement. En ce sens, il y a deux axes à mes recherches : comprendre les pratiques de travail les plus performantes et chercher à combler des lacunes de gestion. Les pratiques associées à la logistique hospitalière ont souvent été mises de côté au profit de la prestation de soins – comment gérer les soins. La logistique est plutôt en périphérie, ses processus sont moins encadrés et étudiés.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Martin Beaulieu : La transposition de certaines pratiques qui se font ailleurs vers le milieu de la santé n’est pas simple. Il y a peu de secteurs d’activités à mon avis qui gèrent une diversité aussi importante de produits. Un établissement de santé peut compter jusqu’à 50 000 codes de produits différents : de la pharmacie à l’alimentation en passant par la fourniture médicale. Wal-Mart va avoir dans ses magasins 75 000 codes de produits différents, mais au final c’est eux qui décident quels produits ils vont vendre tandis que les produits qui se retrouvent dans un établissement de santé sont là pour aider à la prestation de soins, on ne peut pas faire fi de l’avis des professionnels de la santé. On ne peut pas simplement transposer des solutions logistiques issues d’autres secteurs, il faut les adapter.
La logistique hospitalière est un champ de recherche somme toute assez récent. Tout est un peu plus à défricher.
Les processus ne sont pas tout le temps bien définis dans les organisations. Il y a parfois de la difficulté à obtenir des données pour faire les analyses. Les systèmes d’informations ne sont pas toujours conçus pour faciliter l’extraction des données. Les processus ne sont pas toujours matures.
Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet?
Martin Beaulieu : Un de mes patrons a été approché par un distributeur du réseau de la santé qui souhaitait aider le réseau en livrant mieux aux établissements. Environ au même moment une étude importante aux États-Unis a contribué à mousser notre intérêt et ça fait un peu plus de vingt ans qu’on se penche sur ce secteur-là.
On ne veut pas se substituer au mandat des consultants. L’université a une mission de transfert des connaissances, dans les mandats que l’on exécute il y a une opportunité de comprendre des phénomènes et de les appliquer à d’autres réalités, de combler des trous dans la littérature. Le résultat du mandat que nous exécutons va probablement avoir une valeur applicative, mais il faut comprendre que ça s’inscrit dans une réflexion et un processus d’échange avec les établissements et notre groupe de recherche.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Martin Beaulieu : Restez branchés sur les besoins du milieu, tant ceux des gestionnaires que ceux près des lieux de travail. Se trouver des mentors ou des gens qui vont vous introduire sur leurs préoccupations, aller sur leur terrain. C’est un peu la marque de commerce du Groupe de recherche CHAÎNE. On ne peut pas recommander quelque chose dans l’absolu, il faut être capable de saisir les nuances des différents contextes. Par exemple, la logistique du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal qui tient sur quelques kilomètres est différente du CISSS de la Côte-Nord qui se déploie sur des centaines de kilomètres.
Martin Beaulieu chez eValorix
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Marie Alexandre et la didactique
 Marie Alexandre est professeure au baccalauréat de l’enseignement professionnel à l’unité départementale des Sciences de l’éducation de Rimouski à l’UQAR. Elle est membre du Comité scientifique de la revue Formation et profession (Revue internationale en éducation) et du Comité scientifique international de l’Académie nationale des Sciences et techniques du Sénégal.
Marie Alexandre est professeure au baccalauréat de l’enseignement professionnel à l’unité départementale des Sciences de l’éducation de Rimouski à l’UQAR. Elle est membre du Comité scientifique de la revue Formation et profession (Revue internationale en éducation) et du Comité scientifique international de l’Académie nationale des Sciences et techniques du Sénégal.
Expertises
Processus de travail enseignant; construits (schèmes) didactiques; savoir-enseigner; formation de formateurs; environnements numériques d’apprentissage; processus de raisonnement de métier.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Marie Alexandre : Inscrites dans une perspective didactique, mes recherches s’articulent principalement autour de trois axes d’investigation. D’abord, concernant le processus de travail enseignant (savoir enseigner), mes travaux suggèrent que le caractère idiosyncratique du savoir enseigner est un ensemble de manifestations contextualisées découlant de l’exercice d’un processus didactique étonnamment stable. L’analyse d’ensembles d’actions associées aux quatre phases du processus didactique, procure un éclairage sur la manière de réfléchir « un contenu à être enseigné pour être appris par d’autres ». À partir de ce point de vue, les entités de contenus devenus enseignables sont désignées sous le vocable de construits (schèmes) didactiques.
Ensuite, mes travaux en adéquation formation–emploi consistent à modéliser un concept prometteur correspondant au savoir de métier : le processus de raisonnement de métier. Le concept du processus de raisonnement de métier est constitué d’activités-clés et d’actions associées à l’exercice d’un métier en formation professionnelle. Enfin, je travaille en partenariat avec les milieux de pratique en formation professionnelle. En effet, mes activités de recherche sur le savoir enseigner m’amènent à m’intéresser au milieu de pratique et plus spécifiquement au rôle joué par l’un des acteurs importants dans les centres de formation professionnelle : le conseiller pédagogique. J’ai obtenu une subvention dans le cadre du Programme de soutien à la formation continue du personnel scolaire du MELS (2013-2016). Je réalise actuellement une recherche-formation (action) sur l’accompagnement didactique des enseignants des centres de formation professionnelle dans le secteur de la fabrication métallique.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Marie Alexandre : Je vous parlerai de mes défis en lien avec chacun de mes axes de recherche. Ainsi, pour l’avenir, je vise à documenter le processus de travail enseignant, du point de vue des acteurs, par le recueil et l’analyse de données auprès d’un plus grand nombre d’enseignants et d’enseignantes provenant de programmes différents, à des ordres d’enseignement variés incluant les environnements numériques d’apprentissage. Au regard de l’adéquation formation-emploi, il s’agit d’un travail de collaboration entre chercheur et praticiens visant à renforcer le degré d’employabilité des élèves en formation professionnelle et celui de la main-d’œuvre. C’est d’ailleurs dans ce contexte que s’inscrit le laboratoire Paramètres et les guides didactiques. Les rencontres et les entretiens menés auprès d’enseignants, de formateurs hors du contexte scolaire (programmes d’apprentissage en milieu de travail) et de travailleurs ont permis de définir un processus de métier commun contribuant à améliorer l’arrimage entre le monde scolaire et le marché du travail. Enfin au regard du partenariat avec les milieux de pratique, mes travaux en cours ont comme finalité l’élaboration et la réalisation d’une démarche de développement professionnel destinée aux conseillers pédagogiques des centres de formation professionnelle (CFP) et fondée sur l’exercice du processus didactique.
Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet?
Marie Alexandre : L’UNESCO (2013) souligne que l’économie du savoir est en lien avec la notion d’apprentissage tout au long de la vie. Concept clé au XXIe siècle, l’apprentissage tout au long de la vie englobe tous les âges ainsi que toutes les formes d’éducation. Pour sa part, l’Organisation de coopération et de développement économiques soutient que la qualité des enseignants est le premier levier d’amélioration de l’efficacité des systèmes d’éducation (OCDE, 2013). De même, l’UNESCO dans son rapport Enseigner et apprendre : Atteindre la qualité pour tous publié en 2014, fait ressortir qu’un système éducatif ne vaut que ce que valent ses enseignants.
Sur un plan plus personnel, j’ai constaté tout au cours de mon long cheminement scolaire, la capacité de certains enseignants à changer ma vision ou ma façon de penser alors que d’autres n’y arrivaient pas du tout. Ma question depuis le tout début est : Comment fait-on pour «faire apprendre»? En fait, je décrypte l’ADN enseignant. J’explicite la complexité du savoir de la pratique enseignante tout en déboulonnant le mythe de la vocation enseignante – celui de « tu l’as ou tu l’as pas! ».
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Marie Alexandre : Trouver son apport particulier et original au savoir humain . Dans mon cas : L’avènement de l’ère numérique jumelé à la pluralité des savoirs a un impact majeur sur le rôle de l’éducation. Dans ce contexte, une meilleure compréhension de l’adéquation entre le rôle enseignant et les nouvelles compétences requises pour l’apprentissage au XXIe confirme l’importance de la recherche dans le champ didactique. En fait, chercheure en éducation est le plus beau métier du monde ou … presque !
Marie Alexandre chez eValorix
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
Ressources et références
- Paramètres, laboratoire des métiers : http://laboratoiredesmetiers.com/
- Alexandre, M. (2014). Vers la modélisation de construits didactiques : trois études de cas d’enseignantes expérimentées en techniques d’éducation à l’enfance. Formation et profession, 22(2), 57-73. http://dx.doi.org/10.18162/fp.2014.41
- Marie Alexandre, et al (2014). L’utilisation didactique des technologies dans l’accompagnement de stagiaires en formation à l’enseignement. Apprendre et enseigner aujourd’hui, 3(2), 48-54 http://fr.calameo.com/read/001898804fd79b7fd42fb
Anne Mesny, la mesure et les indicateurs

Anne Mesny est professeure titulaire au Service de l’enseignement du management. Elle est également directrice du Centre de cas HEC Montréal.
Expertises
Pédagogie en gestion, utilisation et valorisation des savoirs académiques, apprentissages du métier de gestionnaire, sociologie des organisations, éthique de la recherche en sciences sociales.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Anne Mesny : Je m’intéresse aux relations entre théorie et pratique et à l’utilisation des connaissances scientifiques. Ce qui est frappant quand on regarde la recherche sur l’utilisation des savoirs académiques, c’est qu’on part toujours du principe que les connaissances issues des sciences de la nature sont plus utiles que les celles des sciences sociales. Elles peuvent donner lieu à des résultats plus visibles, par exemple les brevets. Ce que je tente de faire avec mes recherches, c’est de montrer que les savoirs issus des sciences sociales, y compris le management, sont intensément utilisés mais que cette utilisation est moins visible.
Prenons une illustration simple : quelqu’un qui se marie ou qui divorce a probablement entendu parler des taux de mariage et de divorce dans les sociétés modernes ainsi que des explications variées, sociologiques, économiques, psychologiques, anthropologiques, etc., pour rendre compte de ces taux. Ces connaissances proviennent en partie de recherches en sciences sociales, mais la personne qui la mobilise pour mûrir sa réflexion au sujet de son propre mariage ou divorce n’en a pas forcément conscience. Il ne s’agit pas d’une utilisation visible ni instrumentale de la recherche.
Mon intérêt de recherche porte donc sur les manières dont sont utilisées les connaissances issues des sciences sociales, et aussi sur les manières de mieux les diffuser à l’extérieur du monde académique. Je suis aussi à la recherche d’indicateurs, de signaux ou de « marqueurs » pour repérer les utilisations de ces connaissances, alors même qu’une telle utilisation est très difficilement « mesurable ».
En ce sens, la création d’eValorix grâce à l’aide notamment de Nicolas Pinget, m’intéressait en tant que chercheure. En effet, eValorix repose sur l’idée qu’il est possible de transformer des connaissances en sciences sociales ou en gestion en artefacts visibles, comme des méthodes ou des outils de diagnostic qui leur donnent une plus grande visibilité. Au-delà de l’aspect « valorisation », c’est donc surtout l’aspect « visibilité » qui m’intéressait.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Anne Mesny : Le principal défi c’est la mesure et les indicateurs. Dans mes domaines (la sociologie et la gestion) il est très difficile de « mesurer » l’utilisation ou l’utilité de la connaissance. J’aime bien la métaphore de la traçabilité dans les aliments. On est maintenant capable de remonter du steak emballé à l’épicerie jusqu’à la vache chez l’éleveur. Comment est-on capable de tracer la connaissance issue des sciences sociales – comme par exemple un chercheur qui théorise sur l’échec scolaire – jusqu’au moment où cette théorie inspire une politique publique ou même lorsque des parents utilisent cette connaissance pour s’expliquer certains problèmes de leur enfant à leur école? J’aimerais être capable de tracer la connaissance dans tout ce circuit.
Plus la connaissance issue des sciences sociales est diffusée dans la sphère publique, plus elle fait partie du sens commun, plus on en oublie la source initiale. Le paradoxe fait que plus cette connaissance est utilisée, plus il devient difficile de la tracer ou de la mesurer à l’aide d’indicateurs.
Mesurer l’utilisation des connaissances entre chercheurs, c’est facile – bien qu’il y aurait long à dire sur les indicateurs dont on se sert pour le faire. Cela se corse lorsque l’on tente d’évaluer comment les connaissances sortent du milieu académique ou même parfois si elles en sortent.
Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet?
Anne Mesny : J’ai toujours été très étonnée d’entendre que les sciences sociales sont moins utiles que les sciences de la nature. Lorsque j’écoute des conversations dans le métro ou que je lis un article de journal, je vois des sciences sociales et des connaissances qui circulent! Quand telle théorie néolibérale est (re)passée dans le sens commun (après s’en être nourrie puis détachée!) ou qu’un jeune parle de coût de transactions en se demandant quel est le meilleur moyen de s’acheter sa première auto, c’est majeur! Les notions issues des sciences sociales sont extrêmement utilisées, mais c’est mal documenté et mal compris.
Cette utilisation tous azimut des connaissances issues des sciences sociales peut-être bonne ou mauvaise. Il n’y a rien de forcément positif ou émancipateur dans la mobilisation d’une connaissance. Il n’y a qu’à penser à certaines prophéties autoréalisatrices en économie… Je ne veux pas montrer la beauté de l’utilisation des connaissances issues des sciences sociales, mais plutôt montrer qu’on les utilise tout le temps et que ces utilisations sont porteuses de toutes sortes d’effets, positifs et négatifs… Ces connaissances sont des munitions continuelles dans la réflexion et le discours d’un parent, d’un chef d’État ou d’un chef d’entreprise.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Anne Mesny : J’ai peut-être donné, à tort, l’impression qu’il y a une nette séparation entre les sciences sociales et les sciences de la nature. Cette séparation est toute relative. Beaucoup de phénomènes concernant l’utilisation des connaissances – la transformation en « sens commun », les utilisations conceptuelles ou symboliques, etc. – concernent à la fois les sciences de la nature et les sciences du social.
Il y a un fond commun sur la manière dont les connaissances circulent dans les sociétés. Les technologies, l’internet et les réseaux sociaux, transforment en profondeur les façons de diffuser et d’utiliser ces connaissances. Il reste énormément à étudier là-dessus!
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Yves Joanette : le langage et l’évaluation des habiletés de communication

Yves Joanette est professeur titulaire à la faculté de médecine de l’Université de Montréal et chercheur au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Il est également directeur scientifique de l’Institut du vieillissement des Instituts de recherche en santé du Canada.
Expertises
Vieillissement, communication, neurosciences cognitives, démences et lésions cérébrales, dont les impacts des lésions à l’hémisphère droit sur les habiletés de communication (traitement sémantique des mots, discours et pragmatique) et ses implications cliniques (évaluation et prise en charge).
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Yves Joanette : L’intérêt de mon groupe de recherche et le mien est la manière dont les capacités à communiquer sont inscrites dans le cerveau. Ce qui m’a toujours fasciné est comment le cerveau et ses capacités évoluent avec l’âge tout en maintenant ces habiletés de communication de manière optimale. Je m’intéresse aussi à l’effet des lésions cérébrales sur le cerveau, en me focalisant sur des dimensions de la communication ou du langage, un domaine qui a été l’une des premières fenêtres sur la compréhension du fonctionnement du cerveau.
On s’intéressait déjà aux impacts des lésions cérébrales à la fin du 19e siècle sur le langage. Avec mon équipe, nous nous sommes intéressés aux impacts de telles lésions sur des aspects de la communication qui n’avaient pas été pris en compte à ce moment. Quand on pense à la communication, on peut penser aux mots, à l’articulation… mais la communication c’est surtout faire passer un message ou une intention de communication adaptée à l’interlocuteur et au contexte. Bien communiquer, c’est aussi bien organiser sa pensée et son discours. Tous ces aspects de la communication n’avaient pas été pris en compte dans le passé et c’est ce sur quoi se penche mon équipe.
Suite aux nombreux travaux de recherche que nous avons effectués, il nous est rapidement paru important de voir comment on pouvait transformer les connaissances en outils cliniques afin d’aider ceux qui subissent les contrecoups des lésions cérébrales. Pour ce faire, il a fallu impliquer les collègues qui sont aux premières loges: les cliniciens et les cliniciennes. Notre manière de travailler ensemble n’était pas de simplement offrir ce que l’équipe de recherche pensait être le meilleur. Notre collaboration avec eux a été profondément bidirectionnelle. Nous avons ainsi répondu à leurs besoins exprimés, et nous les avons invités à s’impliquer dans le travail de création de ces outils, tout en offrant la rétroaction à notre équipe suite aux premières utilisations de l’outil clinique; un beau travail de communication!
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Yves Joanette : L’interdisciplinarité est une opportunité et un défi. L’apport des autres disciplines et spécialistes permet d’aborder la question qui nous intéresse. L’étude du cerveau est particulièrement interdisciplinaire.
Il faut comprendre le langage de l’autre. L’interdisciplinarité n’est pas la mise en apposition d’une série de bureaux de spécialistes. Il faut créer des cadres de référence et un langage commun, une compréhension commune. Et c’est là le défi !
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Yves Joanette : La complexité du cerveau et son organisation fonctionnelle m’ont toujours fasciné. La communication, l’un des comportements propres à l’humain, est la porte d’entrée et sortie du cerveau !
L’être humain est social, il est connecté aux autres par la communication. Si on est frustré dans sa communication, si on ne se fait pas bien comprendre, on ne peut pas pleinement jouer son rôle dans la société.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Yves Joanette : La recherche fondamentale est nécessaire, mais la recherche appliquée et clinique offre le grand privilège de permettre de voir et de mesurer l’application concrète des connaissances développées, des outils imaginés et des approches au bénéfice de celles et ceux qui ont besoin de notre appui.
Il faut être passionné par la question sur laquelle on veut se pencher. Il faut que les grandes questions auxquelles on s’intéresse nous motivent au plus haut point.
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
Bernard-Simon Leclerc et Joey Jacob : l’évaluation des pratiques et des relations

Bernard-Simon Leclerc est chercheur d’établissement et responsable de l’unité d’évaluation du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Il est également professeur adjoint de clinique à l’École de santé publique de l’Université de Montréal.
Expertises : Épidémiologie sociale, déterminants sociaux, inégalités sociales de santé, enjeux sociaux des services de santé et des services sociaux, évaluation des pratiques, des programmes et des interventions participatives et intersectorielles en général.
Joey Jacob est professionnel de recherche à l’Unité d’évaluation du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l’Île-de-Montréal.
Expertises : Évaluation des pratiques, des programmes et des interventions participatives et intersectorielles, analyse de réseaux, déterminants sociaux, inégalités sociales de santé, enjeux sociaux des services de santé et des services sociaux,
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Bernard-Simon Leclerc : Le centre de recherche et de partage des savoirs InterActions a une thématique qui traite de l’articulation des réseaux personnels, communautaires et publics face aux problèmes complexes. Nous pourrions dire que quelques éléments que nous touchons au centre sont les activités de recherche appliquée dans le domaine du social, l’enseignement, la formation, la mobilisation des connaissances scientifiques et pratiques ainsi que l’évaluation des programmes et des modes d’intervention. Dès que des personnes interagissent ensemble pour résoudre des problèmes, que ce soit des réseaux familiaux ou des réseaux professionnels, cela tombe potentiellement dans notre thématique.
Pour ma part, je suis responsable de l’unité d’évaluation. Nous avons un mandat large qui nous permet d’arrimer les préoccupations du milieu scientifique, celles des milieux de pratique et des autres acteurs du territoire du réseau local de services. Les intérêts d’étude de l’unité peuvent porter par exemple sur l’évaluation des services curatifs, des interventions sociales ou des interventions de santé publique. Nous proposons d’évaluer par exemple les besoins, l’implantation de projets, l’utilisation d’outils ainsi que les effets des interventions ou les pratiques cliniques.
Il est important de comprendre la distinction entre la recherche évaluative et l’évaluation de programmes. En recherche traditionnelle, la préoccupation est de générer de la connaissance pour la communauté scientifique. Dans l’évaluation de programme, les projets répondent plus particulièrement aux besoins de partenaires sur le terrain, c’est du sur-mesure en fonction du problème posé par les acteurs locaux.
Joey Jacob : Par exemple, l’outil « Incitatifs et obstacles à la supervision de stage » disponible sur le site d’eValorix répondait aux besoins de l’ensemble des organisations de soins de santé et de services sociaux de l’île de Montréal. Elles ont fait appel à nos services pour documenter les raisons pour lesquelles il était si difficile de recruter des superviseurs de stage et cela, dans plus d’une vingtaine de professions différentes. Notre projet a permis d’établir des recommandations et de développer différents outils afin d’augmenter le nombre de professionnels qui acceptent de superviser des stages.
Bernard-Simon Leclerc : Nous avons plusieurs projets qui ont gravité autour de cette problématique et nous avons reçu beaucoup de réponses positives des établissements de santé et des universités qui utilisent nos outils. Une forme d’accréditation « Formateur de choix » est même en voit d’être élaborée par le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal afin de créer des conditions favorables à la supervision de stage. Ces travaux se basent sur nos outils. C’est une très belle forme de valorisation de la recherche!
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Joey Jacob : Nous devons nous assurer que les projets d’évaluation que nous réalisons seront pertinents pour les personnes qui les réclament. Notre objectif est d’aider à améliorer leur pratique. Considérant que souvent nos projets ont différents acteurs aux intérêts variés, nous entreprenons tous nos projets avec l’idée que tout le monde en sorte gagnant. C’est un beau défi que de conjuguer l’ensemble des exigences de nos clients!
Bernard-Simon Leclerc : L’un des défis les plus importants est de mobiliser les milieux à participer aux évaluations. La participation n’est pas acquise d’emblée. C’est pourquoi on essaie d’impliquer les participants, de faire de l’empowerment et de leur montrer les avantages de l’évaluation. Nous cherchons à faire des projets axés sur le concret et non pas des projets vagues ou trop ambitieux. On est peut-être un peu à contre-courant de la tendance générale dans le réseau de la santé; nos types d’évaluations répondent moins à des besoins managériaux de haut niveau qu’à des besoins très proches du terrain. On donne une voix à des intervenants qui travaillent plus près de la base, afin de documenter leurs pratiques, de tenter d’y donner une impulsion, de faire connaître leur situation, et de légitimiser leurs activités.
On fait la promotion d’une approche participative des parties prenantes. Nous les impliquons dans le projet afin de le construire ensemble. On aide au développement des pratiques et à l’animation de communautés. Par exemple, à l’IUGM une formation de formateurs en soins palliatifs en soins prolongés a été développée. Deux infirmières de CHSLD qui ont suivi la formation ont souhaité l’implanter dans les milieux. Elles sont venues nous voir et nous avons documenté et évalué le projet-pilote afin de valider la crédibilité de cette initiative.
« Nous privilégions l’exercice de l’évaluation dans un but de développement des connaissances, de soutien à la prise de décision, de promotion du débat démocratique ainsi que d’amélioration des pratiques, plutôt que de répondre à des impératifs essentiellement administratifs […]. Nous attirons l’attention sur une portée avouée de l’évaluation, à savoir sa contribution à l’amélioration des conditions sociales et collectives ou, autrement dit, d’empowerment des individus et des communautés. » Extrait du cadre de référence en évaluation de l’unité d’évaluation d’InterActions
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Bernard-Simon Leclerc : Je viens du milieu de la santé publique, toute ma carrière de chercheur s’y est déroulée. Les approches participatives, j’en ai toujours fait la promotion. J’ai été recruté comme chercheur pour créer une unité d’évaluation au centre InterActions. Les dirigeants partageaient ma philosophie, ils étaient sensibilisés et ouverts à cette forme d’évaluation.
Joey Jacob : Je suis un sociologue de formation. Ce que j’apprécie vraiment de l’unité d’évaluation, c’est notre capacité à répondre aux besoins des partenaires de tous les milieux. Nous pouvons voir leur engouement se développer pour l’évaluation au fur et à mesure que nos projets se concrétisent. L’impact est tellement important pour les acteurs que nous en tirons beaucoup de satisfaction!
Bernard-Simon Leclerc : Quand on fait des travaux de recherche sur plusieurs années, de longue haleine, la gratification est plus longue à venir. Quand on fait des projets d’évaluation avec les acteurs du milieu, on génère de l’information qui est utile plus rapidement.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Joey Jacob : Une des particularités de la recherche dans le domaine social est la difficulté à trouver du financement. Il y a toutefois de très beaux projets pour lesquels il vaut la peine d’y mettre l’effort.
Bernard-Simon Leclerc : Il y a beaucoup d’étudiants au baccalauréat qui ont une conception de la recherche comme étant du travail de laboratoire avec peu de contacts humains. Quand ils découvrent le travail que l’ont fait, ça change leur perspective sur la recherche et l’évaluation en général!
Il faut être tenace et tenir à nos valeurs comme évaluateur, la pression peut parfois être forte de faire une évaluation complaisante. Il faut aussi lutter pour mettre de l’avant le rôle de l’évaluation qui est trop souvent perçu comme un luxe. Le luxe, croyez-moi, c’est de ne pas faire une évaluation!
Bernard-Simon Leclerc chez eValorix
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
Louise Demers et la gérontechnologie
 Louise Demers est professeure titulaire à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal. Elle est également directrice de l’École de réadaptation de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Vice-doyenne associée aux sciences de la santé et chercheure au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
Louise Demers est professeure titulaire à l’École de réadaptation de l’Université de Montréal. Elle est également directrice de l’École de réadaptation de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal, Vice-doyenne associée aux sciences de la santé et chercheure au Centre de recherche de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal.
Expertises : Gérontologie, proches aidants, mesure et évaluation, participation sociale des personnes âgées vivant dans la communauté
La mission d’eValorix est de diffuser les outils numériques issus de la recherche publique. Cette entrevue fait partie de la série d’entrevues avec les femmes et les hommes derrière cette recherche. Les articles tirés de nos conversations informelles paraîtront sous cette rubrique toutes les deux semaines. Inscrivez-vous à l’infolettre afin de rester au courant!
eValorix : À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Louise Demers : « Je cherche à optimiser les services aux personnes âgées qui restent à domicile à travers la technologie. Un élément important pour moi, c’est de considérer les besoins des proches aidants dans la recherche de solutions. En fait, je suis particulièrement intéressée par tout ce qui concerne l’utilisation et le développement des aides techniques utilisées ou destinées aux personnes âgées. On réfère ici à la gérontechnologie, qui est un domaine assez large, allant des aides techniques simples comme les barres d’appui à des appareils plus complexes comme des fauteuils roulants motorisés. Je m’intéresse à de nouvelles technologies comme les piluliers électroniques et les fauteuils roulants motorisés intelligents. Je travaille à évaluer les impacts des technologies existantes et au développement de nouvelles technologies pour les personnes âgées qui ont des déficiences, principalement d’ordre physique. Dans quelle mesure ces technologies ont-elles un impact réel pour réduire le fardeau d’aide des proches-aidants? De fait, chercher à augmenter l’autonomie d’une personne âgée sous-tend qu’on diminue l’aide requise de la part d’autres personnes. Depuis un certain temps, je cible mes recherches sur l’évaluation des impacts de la technologie pour ceux qui donnent de l’aide humaine, en espérant que l’aide technique puisse remplacer l’aide humaine finalement. »
eValorix : Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Louise Demers : « D’un point de vue clinique, passer du développement technologique à une appropriation et à une utilisation sur le terrain, c’est énorme! Il faut réussir à mesurer des effets qui soient réels et concrets. Il y a tout le financement de la dispensation des aides techniques à considérer. Il y a aussi les changements de pratique des cliniciens. Bref, il y a beaucoup de défis.
Pour la recherche, c’est un défi d’étudier les populations âgées fragiles et leurs proches aidants. Il n’est pas facile de recruter des participants, notamment parce que les proches aidants vivent une surcharge. Il y a beaucoup d’attrition dans ce type d’étude, d’autant plus que les conditions de santé des personnes les plus âgées tendent à se détériorer…. Les études longitudinales sont problématiques.
eValorix : Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet?
Louise Demers : « Alors que j’étais ergothérapeute clinicienne, je me posais des questions sur les impacts de ce que l’on fait en réadaptation. Dans quelle mesure est-ce que, au congé des centres de réadaptation, les aides techniques attribuées sont utiles aux personnes qui les reçoivent? Mon intérêt pour la recherche est vraiment parti de cette question. Je me suis engagée dans des études de doctorat et mes recherche se sont orientées dans ce secteur. »
eValorix : Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Louise Demers : « Je crois que c’est vraiment important d’être centrée sur le pourquoi de nos recherches. Il faut s’attacher à des problématiques dont les solutions peuvent répondre à des besoins de la société. Dans le contexte présent, il faut vraiment savoir pourquoi on fait ce travail. Il faut être proche des utilisateurs de la recherche. Il ne faut pas se disperser non plus. Je suggère aux jeunes chercheurs de se tailler une niche dans un secteur qui leur appartient et se l’approprier, et ne pas nécessairement embarquer dans tous les projets disponibles. Même en travaillant en équipe, un chercheur doit être identifié à une thématique. Un jeune chercheur qui accepte d’aller dans trop de différents projets risque de se sentir débordé. Il faut se doter d’un plan, avoir une programmation et une stratégie pour ne pas se laisser submerger. Il faut également aimer ce que l’on fait, parce qu’il y a beaucoup de frustration à la vie de chercheur, notamment avec le financement qui est difficile. Il faut apprendre à se valoriser au-delà de la reconnaissance associée à l’obtention de subvention. »
Texte par Kassandra Martel
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Laurent Lapierre et la méthode des cas en gestion
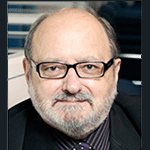 Laurent Lapierre, Ph.D. (McGill), C.M., est professeur honoraire à HEC Montréal. Il a également été directeur général de la Société artistique de l’Université Laval (1968-1970), le premier directeur administratif du Théâtre du Trident (1970-1973), le fondateur du Centre de Cas HEC Montréal et le premier titulaire de la Chaire de leadership Pierre-Péladeau (2001-2013). MBA HEC (1975), il est membre de l’Ordre du Canada depuis 2007.
Laurent Lapierre, Ph.D. (McGill), C.M., est professeur honoraire à HEC Montréal. Il a également été directeur général de la Société artistique de l’Université Laval (1968-1970), le premier directeur administratif du Théâtre du Trident (1970-1973), le fondateur du Centre de Cas HEC Montréal et le premier titulaire de la Chaire de leadership Pierre-Péladeau (2001-2013). MBA HEC (1975), il est membre de l’Ordre du Canada depuis 2007.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Laurent Lapierre : J’ai graduellement compris qu’enseigner la gestion de façon théorique par des cours qui présentent des connaissances ou des modèles normatifs de type ‘’voici comment on devrait faire’’, ne préparent pas vraiment à la pratique de la gestion. C’est intéressant et peut-être rassurant pour les étudiants, mais dans la vraie vie, la gestion ne se passe jamais comme la théorie nous l’a appris. La réalité n’est pas une théorie. La carte n’est pas le territoire. Une carte est utile, voire nécessaire, mais ce n’est jamais le voyage.
Avant de faire mon doctorat, j’ai été le premier directeur du Théâtre du Trident à Québec. Je lisais alors des livres sur « les principes du management », sur comment planifier, organiser, diriger, contrôler… C’était frustrant parce que je savais bien que la gestion au jour-le-jour, c’était plus organique, voire chaotique, et que pour la majorité du temps, là où c’était le plus important ou le plus déterminant, ça ne se passait pas de façon linéaire.
À HEC Montréal, j’ai découvert la méthode des cas qui a longtemps été l’apanage de l’Université Harvard. Plutôt que d’enseigner théoriquement comment on devrait faire, on utilise des histoires de cas. On laisse les étudiants apprendre par eux-mêmes. Idéalement on écrit soi-même les cas dont on a besoin à partir d’entrevues que nous faisons avec de vrais dirigeants. Quand on va en classe, tout le monde a lu cette « histoire », et on vient en classe pour discuter, pour apprendre, pas pour prendre des notes.
Cette pédagogie de type Story Telling fait confiance à l’intelligence des étudiants, à leur désir d’apprendre et de découvrir ce qui peut vraiment leur convenir. L’essence de la gestion, c’est le jugement; et le but de la formation, c’est justement d’affiner leur jugement.
Pour moi, la méthode des cas, c’est ça! Tu t’impliques dans un cours de management, mais il n’y a pas de théories en gestion ou en leadership qui tiennent la route. Si tu étudies les grands dirigeants, tu vas finir par comprendre ce qui a été valable pour eux à leur époque et dans une situation précise, et par te faire une idée de ce qui pourrait être valable pour toi dans une autre situation donnée.
Avant d’arriver dans nos cours, les étudiants ont déjà une bonne idée de ce qu’est la gestion et le leadership. Ils ont déjà beaucoup appris de la vie. Ils savent différencier un leader d’une autre personne qui ne le serait pas par exemple. Les étudiants lisent donc une histoire de cas et ils arrivent prêts pour en discuter en classe. On ne vient pas en classe si on n’a pas lu le cas. C’est d’ailleurs écrit au plan de cours.
Souvent, la discussion commence même avant l’heure du cours. Ils en discutent entre eux au café, par courriels ou dans un forum; ils voient très souvent qu’un autre étudiant n’a pas compris de la même manière qu’eux ou ils découvrent des richesses ou des aspects qu’ils n’avaient pas vus dans cette histoire là. La période du cours n’est que la continuation de cet apprentissage. C’est donc un apprentissage qui se fait principalement par l’étudiant lui-même. Ces séances de formation doivent être passionnantes pour les étudiants.
La plus grande partie du travail du professeur se fait bien avant le cours. Il doit d’abord bâtir un véritable catalogue d’histoires de cas. Pour écrire un cas de 50 pages, ça prend plus de 200 heures. On compte donc 200 heures de préparation pour chaque 75 minutes passées en classe. Mais les étudiants le reconnaissent; ils disent : ‘’enfin, on parle des vraies affaires’’. Une grande partie de la richesse du cours vient de la richesse de ce matériel didactique. L’habileté pédagogique du professeur sert à accoucher ‘‘l’intelligence de gestion’’ de chacun. Il doit rester disponible au happening d’apprentissage qui se passe hic et nunc.
Pendant un cours qui s’échelonne sur un trimestre (28 sessions d’une heure et quart, on peut discuter de 28 histoires de cas différentes. À la fin, les étudiants ont enrichi leur compréhension de ce qu’est la gestion et se découvrent comme gestionnaires en ayant étudié d’autres histoires de cas et en ayant réfléchi sur eux-mêmes.
J’y reviens, la gestion, c’est quelque chose d’organique, de vivant et de chaotique qui évolue tout le temps. Pour moi, la méthode des cas, enrichit l’intelligence et le jugement de l’étudiant. C’est une formation à la pratique qui ne peut pas se faire autrement que par la pratique; celle des autres d’abord et la sienne propre ensuite. La théorie (sous forme de textes d’accompagnement) est enseignée pour mettre l’étudiant en contexte, mais elle est subordonnée parce qu’elle demeure une réduction ou un modèle de la réalité.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Laurent Lapierre : Le principal défi pour enseigner par la méthode des cas, c’est d’arrêter d’être un professeur qui enseigne. Tu dois venir en classe en te disant ‘‘ enseigne le moins possible’’. Si tu te mets à enseigner, les étudiants ne vont pas travailler sur le cas, ils ne se rendront pas responsable de leur apprentissage. Ils vont attendre que tu le fasses à leur place.
Pour moi, il faut donc accepter de perdre ‘‘le beau rôle du professeur’’ pour devenir quelqu’un qui fera accoucher les étudiants de leur intelligence, de ce qu’ils sont vraiment, leur faire découvrir ce qu’est la gestion pour eux et les faire réfléchir sur eux-mêmes comme gestionnaires (voir l’entrevue à ce sujet). J’ai la chance que mes cours portent sur le lien entre personnalité et direction.
Il y a différentes façons de gérer et il y a des cas de mauvaise gestion. C’est important que les étudiants voient ça et comprennent ce qu’ils trouvent de mal approprié là-dedans. Ensuite, ça leur permet de décider ce qui sera valable pour eux. Pour enseigner la méthode des cas, il faut que tu arrêtes de penser que c’est toi qui vas enseigner en arrivant avec ta présentation PowerPoint en leur disant ce qu’ils ont à apprendre.
Par exemple, enseigner la médecine de manière seulement théorique, ça ne préparerait pas les médecins à la pratique. Si tu veux de bons médecins, tu dois t’assurer qu’ils aient les connaissances et les techniques nécessaires, mais tu dois leur présenter de vrais problèmes de médecin avec de vrais patients et les préparer résoudre ces problèmes dans la vraie vie. Tu ne travailles pas avec une théorie quand tu travailles avec un patient, tu travailles avec une personne. Alors, les enseignants leur présentent des problèmes de personne et là, la théorie devient intéressante : tu peux t’en servir, mais c’est la personne qui compte.
C’est la même chose pour la gestion. Qu’a fait tel gestionnaire pour telle entreprise, petite ou grande? Il a pris telles décisions et il a posé tels gestes. Qu’en pensez-vous? Et là tu apprends en te disant ‘’OK, je crois avoir compris pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n’a pas marché’’. Et ce n’est jamais final. La pratique de la gestion n’est pas une science. Et le doute existe toujours.
Tout n’est pas que beau dans une entreprise. La réalité est changeante, souvent inquiétante… Il faut apprendre à composer avec cette réalité, et on espère que les dirigeants sont à l’aise, voire qu’ils aiment œuvrer dans ces contextes. On enseigne très souvent en gestion que ça devrait être planifié et organisé. C’est souvent impossible.
Sans oublier que tu ne gères pas qu’avec des qualités personnelles. Je pense qu’on gère autant avec ses défauts personnels qu’avec ses qualités. Personne n’ose parler des défauts. Si tu as des défauts personnels, tu ne les perds pas en devenant gestionnaire. Tu peux être autoritaire ou impatient, par exemple, mais il faut que tu apprennes à composer avec ces défauts, et surtout à t’en prémunir.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Laurent Lapierre : J’ai commencé ma carrière de gestionnaire comme directeur général de la société artistique à l’Université Laval. Je connaissais pas par expérience ce qu’était cette responsabilité. Ce sont d’autres personnes qui ont jugé que je pourrais faire ce travail. De cette expérience, je suis resté persuadé que le casting est fondamental et que, très souvent, il ne peut pas être fait par la personne elle-même.
Je suis arrivé dans ce poste et j’ai été obligé d’inventer. Plus tard, j’ai été le premier directeur au Théâtre du Trident. D’autres personnes me voyaient dans ce travail que je ne connaissais aucunement. J’avais bien étudié au Conservatoire d’art dramatique, mais je n’avais jamais fait de gestion de théâtre. J’ai été obligé d’inventer ma méthode. Je suis venu rencontrer trois directeurs de théâtre que je connaissais. Je leur ai demandé de me consacrer une journée chacun et je les ai écoutés. Un peu comme si je prenais leur cas pour savoir comment je devais faire. Je leur ai dit : ‘’racontez-moi’’. Ce fut mon cours gestion ça.
Je n’ai pas eu d’autres cours de gestion à ce moment-là. Tu n’as pas le choix d’être ton propre mentor, parce qu’il n’y en a pas d’autres. Tu es seul à faire la job, mais tu ne l’as jamais faite et tu n’as pas étudié ce domaine. Tu n’es donc pas contaminé par les études ni par les théories des autres. Tu peux écouter, lire, étudier, mais tu es donc obligé de trouver ta propre façon pour gérer. C’est ça que j’ai découvert plus tard avec la méthode des cas aux HEC. Tu acquiers le goût d’écouter les autres, autant ceux qui dirigent que ceux qui sont dirigés.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Laurent Lapierre : Pour arriver à vouloir faire de la formation en utilisant la méthode des cas, je pense qu’il faut éprouver une insatisfaction à enseigner la gestion de façon traditionnelle. Ton insatisfaction devient ton véritable moteur. Qu’est-ce qui fait que tu trouves que tes étudiants ne sont pas intéressés ou que ça ne donne pas les résultats que tu veux ? C’est à partir de cette insatisfaction que tu vas vouloir te construire une autre méthode.
Bien sûr, je suis allé à l’école et je m’étais ennuyé jeune. J’ai fait de l’enseignement plus tard et je me suis dit : ‘’il faut que mes élèves aiment ça venir à l’école, il faut qu’ils aiment et qu’ils veillent apprendre ’’. J’ai donc inventé une méthode, inspirée de Célestin Freinet, un grand pédagogue français, parce que je voulais que les élèves sortent à 16 h et se disent qu’ils avaient passé une bonne journée et qu’ils avaient appris de façon intéressante.
Si un jeune professeur n’éprouve aucun malaise à enseigner de façon magistrale ou traditionnelle, s’il pense que c’est ça la bonne façon, je lui dirais de continuer à faire ce qu’il fait. J’ai tellement vu d’utilisation de la méthode des cas qui n’était que de l’enseignement magistral déguisé ! C’est pis que la véritable méthode des cas.
S’il a un malaise cependant, je lui dirais de travailler sur ce malaise pour trouver une façon qui soit plus intéressante pour lui et ses étudiants, et qui leur permettrait d’apprendre mieux, plus vite ou de façon plus solide. Bâtis là-dessus. Essaie de te trouver.
On n’est jamais aussi intéressant qu’on voudrait être, même avec la méthode des cas. Il y a des fois que ça marche de façon extraordinaire, alors qu’à d’autres moments ça ne marche pas, ça ne lève pas. Ça n’arrive pas par magie. La méthode des cas est elle-même un apprentissage très long. Il d’abord désapprendre parce que le système scolaire est basé sur l’enseignement. Il faut apprendre à travailler sur les difficultés de ce métier-là et à aimer ces difficultés qui deviennent des défis.
Je crois que c’est Freud qui a dit qu’il y avait trois métiers impossibles : gouverner, psychanalyser et enseigner. Enseigner est un de ces métiers impossibles. Si tu ne fais que transmettre des connaissances, ça va. Tu fais passer un examen à la fin, et tu mesures si ces connaissances sont sues. Est-ce que les étudiants ont retenu les connaissances que tu leur as transmises en classe? Et ça se mesure !
Ce qu’on enseigne en gestion, c’est une pratique. Avoir des connaissances ne suffit pas. Quand j’ai étudié au Conservatoire d’art dramatique, on ne nous disait pas ‘’voici ce qu’a écrit tel grand acteur ou théoricien du théâtre. Va apprendre ça’’. Non, on nous disait ‘‘on s’en fout des théories, monte sur scène et joue, soit vrai”. En gestion, c’est pareil. Tu as beau avoir lu toutes les théories, si tu ne sais pas ce que c’est de travailler avec des gens pour obtenir des résultats, tu n’y arriveras pas.
P.S. J’ai été chanceux d’étudier au Conservatoire d’art dramatique, en pédagogie, d’avoir été enseignant au primaire et d’avoir été jeté dans la fosse aux lions de la gestion.
Laurent Lapierre chez eValorix
Texte par Kassandra Martel
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Catherine Turcotte et la compréhension en lecture
 Catherine Turcotte est professeure au département d’éducation et formation spécialisées de l’Université de Québec à Montréal (UQAM). Elle est également membre de l’équipe de recherche ADEL : apprenants en difficulté et littératie.
Catherine Turcotte est professeure au département d’éducation et formation spécialisées de l’Université de Québec à Montréal (UQAM). Elle est également membre de l’équipe de recherche ADEL : apprenants en difficulté et littératie.
Expertises
Enseignement et apprentissage de la lecture, Difficultés d’apprentissage de la lecture, Orthopédagogie, Compréhension écrite.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Catherine Turcotte : Le grand thème serait la compréhension en lecture. Tous mes travaux se rattachent de près ou de loin à ce sujet, puisque la compréhension en lecture c’est multidimensionnel.
Ce qui m’intéresse ce sont les élèves qu’on dit à risque d’éprouver des difficultés et ceux qui éprouvent déjà des difficultés, ce qui peut représenter plusieurs types d’élèves. Par exemple, tous les élèves des milieux défavorisés ne sont pas à risque d’échouer, mais certains présentent des facteurs de risques reconnus. Si la langue maternelle parlée à la maison n’est pas la même qu’à l’école, c’est un autre facteur de risque. D’autres élèves ont par exemple une déficience intellectuelle légère. Certains autres enfants ont des difficultés particulières à traiter la lecture et l’écriture. J’ai une grande sensibilité auprès des élèves qui ont plus de difficultés que la moyenne.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Catherine Turcotte : Les défis dans mon champ de recherche se rattachent beaucoup à l’évaluation en compréhension de l’écrit. L’évaluation ça existe : on évalue souvent les élèves. Mais il n’existe pas encore des évaluations adéquates pour comprendre ce que les enfants sont capables de faire au lieu de juste leur donner un résultat global. C’est assez complexe quand on veut comprendre leurs difficultés et comprendre où il faut aller les chercher pour qu’ils surpassent leurs difficultés.
Souvent, on a une très bonne idée des limites des enfants, mais on n’a pas une bonne connaissance de ce qu’ils arrivent à faire et de ce qu’ils ont comme potentiel.
On ne sait donc pas comment les aider. On a de super belles évaluations standardisées qui nous disent qu’un élève montre des performances « deux ans plus jeune » que tous les autres élèves de sa classe, par exemple. Mais qu’est-ce qu’on fait maintenant avec ça? Ça ne nous indique pas comment intervenir pour qu’il arrive à rattraper les autres élèves. Ça nous donne un score par rapport à une norme. Je veux contribuer à outiller les enseignants.
Par exemple, avec mes travaux sur le vocabulaire dans le cadre de l’équipe ADEL (Apprenants en difficulté et littératie), on a essayé d’évaluer le vocabulaire des enfants avec d’autres instruments. Pas juste avec des listes ou des questions comme « pointe-moi c’est quoi, dans les quatre images suivantes, un ballon ». Dans nos séances, on essayait de faire parler les élèves, en les notant autrement, en fonction des mots qu’ils expriment et des liens entre ces mots.
Dans un autre guide pédagogique qu’on va soumettre bientôt à eValorix, on parlera des activités qu’on peut faire en classe, mais aussi de nouvelles épreuves qu’on peut utiliser pour déterminer plus spécifiquement quels sont les problèmes de compréhension en lecture des élèves. Souvent, on dit d’un élève « qu’il ne comprend pas » ses textes. Mais quoi exactement, quel type de questions ne comprend-t’ il pas? On est plus dans cette précision-là.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Catherine Turcotte : J’ai fait une formation initiale en enseignement au primaire. Je m’étais destinée à devenir une enseignante au primaire, mais dès que je suis sortie de l’université, je me suis rendu compte que ce qui me préoccupait le plus dans une classe, c’était les élèves qui ne lisaient pas bien. J’ai donc fait une maîtrise. À l’époque, il y avait une professeure à l’Université Laval qui était spécialisée dans le domaine. Elle était reconnue partout. C’est donc avec elle que j’ai fait ma maîtrise. À partir de là, peut-être naïvement, je pensais que ça répondrait à mes questions. Ça été le contraire, ça en a généré beaucoup plus! Alors, je suis allée faire une thèse de doctorat pour réaliser un moment donné que je n’aurais jamais toutes les réponses. Il fallait juste que j’essaie de répondre à quelques questions et que si je réussissais à contribuer un petit peu à ce champ-là, je serais contente.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Catherine Turcotte : Il va toujours y avoir beaucoup de travail. Il n’arrivera jamais au bout. Ce qui est intéressant, c’est qu’en ce moment on est capable de trouver certaines réponses. Ce n’est pas vrai qu’on est toujours dans le néant. Tous les travaux qu’on fait nous apportent des réponses et nous apportent aussi soit de nouvelles questions, soit de nouvelles occasions de réfléchir à une autre problématique. Jusqu’ici, mes travaux m’avaient amenée à travailler dans des classes ordinaires et en orthopédagogie, mais un jour, une collègue m’a dit « tout ce que tu fais, j’aimerais bien le tenter avec des élèves qui ont une déficience intellectuelle, qui sont dans une classe spéciale ». C’est comme un nouveau champ de problèmes et de possibilités qui s’ouvre. Ensemble, nous avons travaillé là-dessus. J’ai été confrontée à ce type d’élèves qui ont des caractéristiques particulières sur le plan de la mémoire et de l’attention, que je rencontrais moins avec des élèves, disons, typiques. C’est encore un autre niveau d’ajustement. Ce que je dirais aux personnes qui commence à s’intéresser à ce champ-là, c’est que c’est un champ d’intérêt qui touche aussi toute sorte d’élèves. C’est pour cela que ce n’est jamais fini non plus. La lecture et l’écriture c’est présent partout.
Tout le monde doit avoir un bon niveau de lecture. C’est donc un champ qui est transversal, c’est transdisciplinaire.
Catherine Turcotte chez eValorix
Texte par Kassandra Martel.
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Marc-Antonin Hennebert, les relations de travail et le syndicalisme
 Marc-Antonin Hennebert est professeur agrégé au Département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal. Il est également membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT)
Marc-Antonin Hennebert est professeur agrégé au Département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal. Il est également membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT)
Expertises
Relations de travail, syndicalisme, négociation collective, firmes multinationales et responsabilité sociale.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Marc-Antonin Hennebert : Mon domaine de recherche est celui des relations de travail et du syndicalisme. À HEC, il fait partie de la sphère plus large de la gestion des ressources humaines (GRH). À ce titre, deux projets de recherche concernant le monde syndical m’ont plus particulièrement occupé au cours des dernières années.
Le premier, de nature plus internationale, concerne la montée en nombre et en puissance des entreprises multinationales et l’implication de ce phénomène sur la régulation du travail. La question au cœur de ce projet est de savoir comment les travailleurs et leurs représentants peuvent s’assurer du respect des droits sociaux fondamentaux des employés au sein des multinationales, mais aussi au sein de leurs réseaux de sous-traitants et de leurs chaînes de valeur? À cet égard, certaines organisations syndicales ont innové au cours des dernières années en développant de nouvelles pratiques de concertation intersyndicale au plan international et en construisant des coalitions et des alliances plus ou moins formelles selon les cas. Ces alliances regroupent généralement des syndicats qui représentent les travailleurs d’une même multinationale dans ses différents établissements à travers le monde et cherche d’ordinaire à ouvrir un dialogue avec la direction de ces entreprises pour assurer un meilleur respect des droits des travailleurs notamment dans les pays où les structures institutionnelles en matière de travail sont déficientes. Ce thème de recherche se veut très proche de celui de la responsabilité sociale des entreprises, mais vu sous l’angle syndical.
Dans un contexte de transformations des milieux de travail, mon deuxième projet de recherche s’intéresse à la réalité des représentants syndicaux au sein des entreprises et à la problématique du renouvellement du leadership de ces représentants. En effet, la complexification observée du travail de ces représentants, et notamment des présidents de syndicats locaux auquel ce projet s’intéresse de manière particulière, les placent aujourd’hui devant de nombreux défis et soulève des questions quant aux meilleures pratiques en matière de représentation syndicale. Ce projet de recherche vise un objectif fondamental, soit celui d’identifier, selon notamment certains contextes sectoriels déterminés, comment les représentants syndicaux composent avec de tels défis et comment certains parviennent à devenir des acteurs stratégiques à la fois au sein de leur syndicat et de leur entreprise.
Quels sont les principaux défis dans votre champ de recherche?
Marc-Antonin Hennebert : Les organisations syndicales avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années sont confrontées à de multiples défis provenant à la fois de leur environnement externe et interne. Dans le premier cas, je pense notamment à la mondialisation, aux recompositions sectorielles (les emplois se développent aujourd’hui surtout dans des secteurs moins syndiqués), aux besoins nouveaux des employeurs (réductions de coûts, flexibilité dans l’organisation et les conditions de travail), etc. Concernant l’environnement interne, les membres des syndicats ont également des besoins nouveaux notamment en matière de conciliation travail-famille et leurs intérêts sont plus diversifiés qu’auparavant. Les organisations syndicales, comme les entreprises, sont donc aujourd’hui condamnées à revoir leurs pratiques pour s’ajuster à leur nouvel environnement.
En outre, dans un contexte où les ressources humaines se positionnent de plus en plus comme une source d’avantage compétitif, les relations de travail peuvent venir jouer un rôle plus important dans la définition de la compétitivité des entreprises. Cela place les acteurs syndicaux dans une position où ils peuvent potentiellement jouer un rôle de partenaire stratégique au sein de leur organisation. Dans ce contexte, je me pose certaines questions de portée générale : Quelle est l’état actuel des relations de travail dans nos entreprises au Québec? Quelles sont les défis inhérents à une saine gestion des relations de travail? Quelles sont les meilleures pratiques relativement à l’implication des syndicats au sein des processus de changement des entreprises ?
Au fil de nos recherches, nous avons toujours eu un accueil très positif des entreprises et des organisations syndicales impliquées dans nos projets. Nous cherchons aussi à avoir des conclusions pratiques qui peuvent offrir autant d’outils réflexifs à nos partenaires de recherche et les guider dans leurs pratiques.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Marc-Antonin Hennebert : Alors que j’étais étudiant en gestion, je me suis rendu compte qu’on étudiait beaucoup les organisations du point de vue de ses dirigeants et de ses principales sphères de pouvoir. Toutefois l’entreprise est un lieu pluriel où s’entremêlent intérêts et groupes divers. Évidemment, il est fondamental d’étudier la réalité des gestionnaires pour comprendre les organisations, mais je trouvais néanmoins qu’on ne s’intéressait pas assez aux formes de contre-pouvoirs au sein des organisations dans lesquels les syndicats jouent un rôle assez important. Mes premières recherches m’ont démontré que, parfois dans une même entreprise, les dirigeants et gestionnaires, d’une part, et les représentants syndicaux et les travailleurs, d’autre part, ont parfois une vision très différente de leur réalité organisationnelle.
L’étude des relations de travail et du syndicalisme est donc pour moi une manière importante de contribuer à la compréhension de nos univers organisationnels. Elles permettent notamment d’exposer le point de vue des travailleurs et de leurs représentants, soit un peu l’envers de la médaille.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Marc-Antonin Hennebert : J’ai récemment écrit un texte dans la revue de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (ORHRI) qui témoigne un peu de ma vision des relations de travail en entreprise et des conseils que je donnerais aux gestionnaires dans ce domaine (pour consulter le texte intégral en étant membre de l’Ordre suivre ce lien HENNEBERT, Marc-Antonin. 2014. « Entre les méandres de la conflictualité et l’idéal collaboratif : gérer ses relations de travail de manière réaliste ! ». Effectif, revue de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, vol. 17, no. 2, p. 14-19. )
Il est tout d’abord important de reconnaître la pluralité des intérêts dans les organisations. La formation des étudiants au sein des écoles de gestion peut parfois donner une vision unitaire des organisations masquant les intérêts potentiellement différents de certains groupes. Comprendre la diversité des intérêts au sein des organisations est pour moi fondamental!
Il me semble également important pour tout gestionnaire RH de saisir la responsabilité et les contraintes des représentants syndicaux et pallier au manque de connaissances des autres gestionnaires en cette matière. Les relations de travail sont encadrées par un régime juridique (notamment le code du travail) qui crée des obligations de toutes sortes dont celle pour les représentants syndicaux de s’assurer de défendre leurs membres de manière juste et équitable. La réalité est la même du côté des gestionnaires : il existe une obligation de négocier de bonne foi le renouvellement des conventions collectives, de reconnaître et de ne pas entraver les activités syndicales, de respecter la procédure de grief, etc. Il est donc impératif de connaitre ses responsabilités et ses obligations légales.
Il faut aussi accepter, comme gestionnaire RH, les désaccords potentiels avec les syndicats et même l’impossibilité de s’entendre sur certains enjeux, tout en cherchant à minimiser les impacts à long terme sur les relations patronales-syndicales. Fonctionner par consensus est un idéal qui n’est pas toujours à l’épreuve de la réalité. Le défi pour un gestionnaire en relations de travail n’est pas d’éviter à tout prix les désaccords, mais de chercher à minimiser leurs effets sur les relations entre les parties à plus long terme.
Finalement, il ne faut pas avoir peur d’innover et de remettre en cause les pratiques dans le domaine des relations de travail. Le monde des relations de travail en est un au demeurant assez conservateur dans la mesure où les pratiques et façons de faire se sont instituées au fil des années (négociations collectives, procédure de grief, etc.) et qu’elles évoluent plus lentement que dans d’autres domaines. Il ne faut pas avoir peur d’innover, de remettre en cause certaines pratiques. À titre d’exemple, on observe aujourd’hui dans certaines entreprises le désir d’établir une culture du dialogue plus soutenue entre les parties par l’intermédiaire de la création de comités de négociation continue visant à faire évoluer les conditions de travail entre les périodes plus formelles de renouvellement de la convention collective. Des syndicats jouent aussi un rôle plus important dans les sphères décisionnelles des entreprises ce qui apparaît comme une avenue intéressante, même si elle représente un défi important pour les parties, pour le renouvellement de nos relations de travail.
Marc-Antonin Hennebert chez eValorix
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
Lucie Richard et les pratiques professionnelles en santé publique
 Lucie Richard, Ph.D. est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières et directrice de l’Institut de Recherche en Santé Publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) où elle détient également un poste de chercheure régulière.
Lucie Richard, Ph.D. est professeure titulaire à la Faculté des sciences infirmières et directrice de l’Institut de Recherche en Santé Publique de l’Université de Montréal (IRSPUM) où elle détient également un poste de chercheure régulière.
Expertises
Prévention de la santé, promotion de la santé, approche écologique en santé publique, analyse étiologique, évaluation d’interventions spécifiques.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Lucie Richard : Je tente d’aider les praticiens à renouveler leurs pratiques et aider les chercheurs qui font de la recherche sur le renouvellement des pratiques. Il y a beaucoup de mouvement en santé publique depuis une trentaine d’années : des nouveaux modèles d’analyse et d’action, des réorganisations successives des services, etc. C’est important de soutenir les praticiens dans ces nombreuses transitions. Par exemple, il n’y a pas si longtemps encore, la santé publique fonctionnait dans une logique très éducative; en éduquant les gens, en leur donnant de l’information sur quoi faire pour améliorer leur santé, on croyait avoir la clé pour les guider vers les changements souhaités en matière de comportements. La santé publique a évolué vers de nouvelles perspectives, vers de nouveaux modèles pour guider la réflexion et l’action. Sans omettre l’action sur les comportements, ces nouveaux outils encouragent les praticiens à développer des interventions qui visent à modifier les environnements dans lesquels les personnes vivent, à agir sur ces déterminants sociaux.
Par exemple pour réduire le tabagisme, on sait maintenant qu’un travail exclusif sur les connaissances, les attitudes et le comportement des individus ne fonctionne pas. Les gains populationnels majeurs dans ce domaine sont survenus suite à des interventions modifiant des déterminants clés du tabagisme : la taxation, l’aménagement d’aires sans fumée, la publicité, etc. Bref, la santé publique et la promotion de la santé mettent de l’avant un travail sur une diversité de déterminants de la santé et pas seulement ceux propres au comportement individuel.
Au fond, quand on s’arrête et qu’on y pense, on comprend que les conditions dans lesquelles les gens vivent sont souvent celles qui les rendent malades.
En remontant à la source, en modifiant ces facteurs on peut faire des gains au niveau de la santé des populations. Si on ne s’attaque pas à ces facteurs, nous restons cantonnés dans une logique où on soigne des gens malades. Il faut continuer à le faire, je ne dis pas qu’il faut fermer les hôpitaux! Mon agenda de recherche est sur la prévention et la promotion de la santé. La promotion c’est mettre en place des conditions qui vont garder les gens en santé.
Un de mes axes de recherche a trait au rôle des praticiens dans le contexte de l’émergence de ces nouvelles pratiques. Dans les organisations locales de santé publique, le discours du nouveau mouvement de santé publique est arrivé il y a plus de 20 ans, mais avant qu’il percole dans les pratiques, ça prend du temps. Les praticiens nous disent manquer d’outils ou de formation pour travailler à modifier les environnements. On vise à mettre sur pied des ateliers et des formations, c’est notamment un des objectifs du guide déposé sur eValorix. À ce stade-ci, il faut mentionner que le guide sert surtout à des fins des recherches. Par exemple, des équipes l’utilisent afin de documenter l’intégration de nouvelles approches au sein des programmes. À plus long terme, notre souhait est que le guide soit utile aux praticiens visant un travail sur les environnements, les déterminants sociaux.
Dans le cadre de mon projet de recherche actuel, je suis en train de mettre sur pied des interventions de développement professionnel destinées aux professionnels des CISSS et CIUSSS afin de les accompagner pour qu’ils puissent améliorer leurs pratiques, travailler sur plusieurs déterminants de la santé et sur l’environnement.
Quels sont les principaux défis dans votre champ de recherche?
Lucie Richard : J’en vois deux. Premièrement, trouver des façons d’appliquer les connaissances dans les milieux de pratiques. Les praticiens sont souvent débordés et les chercheurs pas toujours à même d’offrir des opportunités porteuses en terme de développement professionnel. Il faut trouver les bonnes modalités pour mieux soutenir l’implantation d’approches innovantes, telles celles s’appuyant sur une approche écologique.
Deuxièmement, quand on fait des coupes en santé, c’est souvent la prévention qui écope. C’est ce qui est moins visible.
La prévention quand on a du succès, ça ne fait pas de bruit.
Si on réduit les dommages des accidents routiers – parce que les gens portent leur ceinture, parce que les voitures sont mieux conçues, parce qu’on a travaillé sur les tracés des routes, grâce aux campagnes de prévention de l’alcool au volant – cela réduit l’incidence des accidents, mais ça ne fait pas la manchette.
Quand on coupe dans la prévention, il n’y a personne qui crie.
Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet?
Lucie Richard : Ma formation de base est en psychologie. C’est beaucoup par le biais de la psychologie communautaire, des cours au niveau du baccalauréat qui ouvraient nos horizons sur les questions d’amélioration des conditions de vie. J’ai eu une première expérience de travail dans les milieux de santé communautaire. J’ai trouvé que c’était un bon champ d’application pour les connaissances en psychologie que j’avais acquises. J’ai découvert que c’est un univers fascinant.
Le Canada est un leader au sein du mouvement de la nouvelle santé publique et de la promotion de la santé.
Je suis entrée en santé publique au moment de l’introduction de ce nouveau discours. Ça m’intriguait, je trouvais ça impressionnant, mais je me demandais comment nous allions implanter ça dans la pratique.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Lucie Richard : C’est un domaine captivant, nous sommes à la croisée de plusieurs disciplines. Par exemple, dans le cas de la sécurité routière, la santé publique collabore avec des ingénieurs, des urbanistes, des psychologues, des communicateurs, etc. Il y a là un champ d’applications formidable quand on travaille sur des problèmes sociaux.
C’est extrêmement stimulant et difficile également. Nous travaillons en interdisciplinarité, il faut apprivoiser le vocabulaire et l’approche de l’autre. Ce qui nous intéresse en santé publique, ça appelle forcément à la collaboration de plusieurs disciplines. Et le potentiel d’impact est immense.
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
Entrevue : Nina Admo et la médiation sociale
 Nina Admo enseigne la criminologie au département des Techniques auxiliaires de la justice du Collège de Maisonneuve et à la Faculté de l’éducation permanente de L’Université de Montréal. Elle est également chercheure au Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal et à l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI).
Nina Admo enseigne la criminologie au département des Techniques auxiliaires de la justice du Collège de Maisonneuve et à la Faculté de l’éducation permanente de L’Université de Montréal. Elle est également chercheure au Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal et à l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI).
Expertises
Ses intérêts de recherche portent notamment sur la médiation sociale, la résolution des conflits, la médiation pénale et la justice réparatrice.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Nina Admo : Mes travaux portent sur l’évaluation de l’implantation et des impacts de projets en médiation sociale ou urbaine. Je fais de la recherche-action qui implique que le chercheur soit présent sur le terrain. On récolte les premiers résultats pour ensuite corriger le tir avec l’équipe sur les lieux et continuer l’évaluation par la suite.
Je cherche, à l’instar d’autres chercheurs dans le domaine, à développer des processus alternatifs à la résolution des conflits citoyens, notamment par la médiation. Certains nouveaux processus vont inclurent plusieurs groupes d’acteurs. Prenons par exemple le bruit d’un bar dans un quartier, cela donnera lieu à une méga médiation ou ce que nous appelons cercle de dialogue ou de résolution de problèmes qui impliquera des représentants citoyens, du bar, de la police, de la ville, etc. Le but est de les rassembler tous autour de la même table avec un médiateur impartial qui va venir organiser les échanges entre eux. Bien que mon champ de recherche soit la médiation sociale, je commence à m’intéresser à d’autres thématiques.
Je travaille présentement avec une équipe sur le terrain sur un projet de prévention de la radicalisation menant à la violence dans des écoles. La médiation peut être une des solutions à ces « crises des interactions sociales ».
Quels sont les principaux défis dans votre champ de recherche?
Nina Admo : Les initiatives sont un éternel projet-pilote que les villes et les institutions ont tendance à relancer à chaque fois, il n’y a pas de continuité.
Les pratiques n’ont pas levé au Québec. La médiation n’a pas su se dégager comme une alternative légitime.
En Belgique, par exemple, les gens ne peuvent plus appeler au 911 pour certains conflits de voisinage. Le service de médiation est institutionnalisé. On reconnaît l’apport de ces pratiques dans la gestion des conflits humains.
Dans ce qui se fait au Québec, l’offre est très éclatée et le titre de médiateur social n’est pas un titre protégé au Québec. En médiation sociale, il y a des organismes communautaires qui offrent en effet des services de résolutions de conflit souvent gratuits, entre autres, en guise d’alternative au système pénal ou civil. Par contre, il y en a d’autres qui parlent de médiation culturelle alors qu’il est plutôt question d’ateliers de sensibilisation à l’autre. Certains intervenants sociaux aident leurs clients dans la résolution de certains conflits interpersonnels et estiment ainsi qu’ils offrent une forme de médiation. Il n’y a pas de consensus entre les pratiques. L’offre est tellement différente qu’on ne s’entend pas sur le terrain ce que constitue la médiation sociale. Alors que quand on parle de thérapie, par exemple, tout le monde s’entend sur certains paramètres.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Nina Admo : Ils ne peuvent pas vivre de ça (rires)! Il n’y a pas vraiment de travail à temps plein dans le domaine de la médiation sociale et pénale. En parallèle de ma recherche, je vis de l’enseignement. Par contre, ce sont des milieux de travail et de recherche extrêmement stimulants!
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
