Posts Tagged ‘HEC Montréal’
Help make your management courses a success with case studies from HEC Montréal
Whether in class, online or blended, HEC Montréal‘s case studies will help support your teaching objectives and make your classes more engaging. eValorix offers more than 1,400 downloadable case studies written by internationally renowned professors from HEC Montréal.
You will find case studies in French, English and Spanish, covering various topics such as:
- Entrepreneurship
- Finance and accounting
- Human resources
- Information technology
- Leadership and organizational behaviour
- Management and strategy
- Marketing
- Operations and logistics management
We also offer a 10% discount for pre-paid packages of 10 case studies. For more information, contact us at info@evalorix.com.

Serge Poisson-de Haro et les enjeux stratégiques des organisations artistiques

Serge Poisson-de Haro est professeur agrégé au département du management à HEC Montréal.
Expertises
Stratégie, capacités dynamiques, gestion des arts, organisation et environnement naturel, gestion des organisations artistiques.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Serge Poisson-de Haro : Premièrement, ce qui m’intéresse ce sont les enjeux de gestion et les enjeux stratégiques des organisations artistiques. Je suis professeur de stratégie et j’étudie depuis plusieurs années les organisations artistiques montréalaises, telles que le Musée des beaux-arts de Montréal, le Musée d’Art Contemporain, l’Opéra de Montréal, l’Orchestre Symphonique de Montréal, l’Orchestre Métropolitain, le Festival Montréal en lumière et les cirques tels le Cirque Éloize, le Festival Montréal Complètement Cirque, etc. En tant que professeur de stratégie, j’analyse leurs divers enjeux et je tente d’appliquer des modèles d’analyse stratégique classique pour conduire des analyses de leurs contextes, interne comme externe. La théorie des ressources en est un. À l’interne, j’analyse les ressources et les compétences dont dispose la compagnie pour évaluer celles qui permettraient de développer un avantage concurrentiel. Également, le concept de modèle d’affaire, une littérature stratégique émergente depuis plusieurs années, permet de définir sa proposition de valeur et comment s’organiser à l’interne pour livrer le service au client cible. Le tout requiert de bien comprendre le positionnement stratégique d’une organisation au sein de son environnement externe, tant concurrentiel qu’au sens plus large. Ce sont tous ces éléments que je tente de prendre en considération dans une analyse stratégique.
Deuxièmement, j’aime beaucoup la pédagogie et les méthodes expérientielles pour enseigner la gestion stratégique. Je favorise méthode des cas ou encore l’utilisation de simulation informatique répliquant les dynamiques concurrentielles au sein d’un secteur donné. 90% de mon enseignement est expérientiel. Je fais très peu de cours magistraux, car je préfère lorsque l’étudiant est acteur de la situation et des analyses à faire pour trouver les solutions aux enjeux de gestion. Une partie de ma recherche est d’ailleurs dédiée à la pédagogie.
C’est par le biais de la pédagogie que je me suis penché sur l’analyse stratégique des organisations culturelles. Cela correspondait à ma volonté de comprendre les spécificités du tissu culturel à Montréal à mon arrivée dans la métropole. C’est la rédaction de cas sur des organisations locales de renom qui m’a mené à lancer le projet de recherche : « Les Enjeux de gestion au XXIème siècle ». Cette recherche m’a permis, par exemple, de largement analyser les enjeux de gestion vécus par le Musée des beaux-arts de Montréal. J’ai relevé comment, par un meilleur ancrage local, le musée a pu rayonner à l’international. De par ses stratégies, ses choix de mieux s’ancrer localement, de s’appuyer sur des compétences locales et de créer des expositions temporaires qui ensuite voyagent à travers le monde, le MBAM est devenu le premier musée au Canada, avec plus d’un million de visiteurs par année. Une exposition comme celle de Jean-Paul Gauthier, entièrement créé au Québec avec des compétences locales, fait actuellement le tour du monde et favorise le rayonnement international du musée. C’est important localement pour encourager la communauté montréalaise de soutenir son musée pour assurer son succès ici et ailleurs.
Finalement, on peut dire que le nerf de la guerre, comme pour toute organisation, c’est d’assurer l’équilibre financier tout en étant fidèle à sa mission. Les enjeux des organisations artistiques se situent grandement au niveau du financement. On parle généralement d’organisation sans but lucratif. Ces organisations sont davantage financées par des fonds publics (trois paliers de gouvernement), des donateurs privés, des commandites mais aussi par la capacité de l’organisation à générer des revenus autonomes comme les recettes de billetterie. L’équilibre financier est certainement un des enjeux majeurs des organisations artistiques et celui-ci passe par la fidélisation et le renouvellement du public. L’objectif est de renouveler l’offre et ainsi attirer une nouvelle clientèle, tout en restant fidèle à la ligne directrice artistique. L’optimisation organisationnelle de chaque dollar dépensé est centrale. L’objectif est d’être en mesure de faire plus avec moins. Dans les organisations artistiques, on est loin de la quête de profit, on aspire avant tout à faire vivre la mission artistique. Par ailleurs, il est important de changer la perception commune du grand public, à savoir que la culture se doit d’être gratuite. Cette perception est grandement alimentée par les nombreux festivals culturels gratuits, mais cette même perception distancie le grand public des enjeux de financements vécus par les organisations artistiques.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Serge Poisson-de Haro : Le défi est d’innover et d’être ancré dans les défis quotidiens de ces organisations. Comment les outils développés dans le milieu des affaires peuvent-ils être pertinents au secteur des arts, comment adapter l’existant? L’enjeu est aussi de trouver quelque chose de nouveau en termes de gestion, qui serait issu de la complexité du secteur des arts. On pourrait exporter certaines pratiques vers le monde de l’entreprise, pour que celui-ci puisse apprendre du secteur des arts. Le défi est de faire une sorte de boucle entre les deux. Comme l’équation financière des organisations artistiques est particulière, elle implique une gestion plus complexe avec les parties prenantes. Ces organisations doivent aller chercher des dons, des subventions gouvernementales et gérer les attentes d’un plus grand nombre de parties prenantes, comparativement à la plupart des entreprises qui se soucient prioritairement des attentes des clients et des actionnaires. Les entreprises peuvent apprendre à mieux s’intégrer dans leurs communautés en observant ce que font les organisations artistiques. La polyvalence, la capacité à faire plus avec moins et cette gestion complexe des parties prenantes sont les connaissances clés en gestion des organisations artistiques. Et elles sont valides pour des organisations autres qu’artistiques.
Je me dis souvent que ce qui différencie probablement le secteur des arts du monde de l’entreprise, c’est qu’il donne avant tout des émotions. Beaucoup d’entreprises ont du mal à trouver le sens de l’émotion spontanée. Je crois que les rêves véhiculés par l’art sont ce qui nous rend humains. Ce sont ces souvenirs qui nous restent et nous rendent heureux, beaucoup plus que nos possessions matérielles qui se périment par obsolescence programmée. Je crois qu’il est important que ces organisations qui donnent des émotions restent pérennes, car elles créent des instants de vie dont on se souvient longtemps. Elles permettent même parfois de transcender le quotidien.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Serge Poisson-de Haro : L’intégration du développement durable comme source d’avantage concurrentiel pour les compagnies fut ma thèse universitaire. C’est un peu une thèse pour « sauver le monde ou rendre le monde meilleur » en voulant encourager les entreprises à contribuer au système économique tout en ayant un impact social et environnemental positif. C’est ce côté un peu idéaliste que j’ai, mais aussi par intérêt personnel que je me suis tourné vers le milieu artistique. Un monde sans artistes serait triste, mais ceux-ci ont généralement besoin de renforcer leurs compétences de gestion. C’est cet aspect qui a en quelque sorte démarré mon intérêt pour les organisations artistiques. Étant un Canadien adoptif (d’origine française), cette passion pour les arts, mon penchant pour la stratégie en général et pour les stratégies des organisations artistiques en particulier m’ont, en quelque sorte, permis d’apprendre et de mieux m’intégrer à l’écosystème montréalais, notamment culturel.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Serge Poisson-de Haro : Il est important d’écouter les praticiens et de comprendre leurs difficultés quotidiennes. Il faut se mettre au service de leurs problèmes très concrets avec une rationalité et une rigueur académique, pour tenter de trouver une interprétation possible à ce qui se passe et éventuellement trouver des solutions. Il faut démarrer sur le terrain, connaitre les théories et qu’elles soient au service de l’explication du sujet observé. C’est grâce au lien entre ces théories académiques et les situations concrètes qu’émergent souvent des solutions durables. Il est important de rester collé à la réalité tout en prenant du recul pour l’analyse. C’est en faisant des ponts entre l’observation et la théorie qu’on peut créer de nouvelles théories et de nouvelles solutions.
Serge Poisson-de Haro chez eValorix
Texte par Fanny Vadnais
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Anne Mesny, la mesure et les indicateurs

Anne Mesny est professeure titulaire au Service de l’enseignement du management. Elle est également directrice du Centre de cas HEC Montréal.
Expertises
Pédagogie en gestion, utilisation et valorisation des savoirs académiques, apprentissages du métier de gestionnaire, sociologie des organisations, éthique de la recherche en sciences sociales.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec vos recherches?
Anne Mesny : Je m’intéresse aux relations entre théorie et pratique et à l’utilisation des connaissances scientifiques. Ce qui est frappant quand on regarde la recherche sur l’utilisation des savoirs académiques, c’est qu’on part toujours du principe que les connaissances issues des sciences de la nature sont plus utiles que les celles des sciences sociales. Elles peuvent donner lieu à des résultats plus visibles, par exemple les brevets. Ce que je tente de faire avec mes recherches, c’est de montrer que les savoirs issus des sciences sociales, y compris le management, sont intensément utilisés mais que cette utilisation est moins visible.
Prenons une illustration simple : quelqu’un qui se marie ou qui divorce a probablement entendu parler des taux de mariage et de divorce dans les sociétés modernes ainsi que des explications variées, sociologiques, économiques, psychologiques, anthropologiques, etc., pour rendre compte de ces taux. Ces connaissances proviennent en partie de recherches en sciences sociales, mais la personne qui la mobilise pour mûrir sa réflexion au sujet de son propre mariage ou divorce n’en a pas forcément conscience. Il ne s’agit pas d’une utilisation visible ni instrumentale de la recherche.
Mon intérêt de recherche porte donc sur les manières dont sont utilisées les connaissances issues des sciences sociales, et aussi sur les manières de mieux les diffuser à l’extérieur du monde académique. Je suis aussi à la recherche d’indicateurs, de signaux ou de « marqueurs » pour repérer les utilisations de ces connaissances, alors même qu’une telle utilisation est très difficilement « mesurable ».
En ce sens, la création d’eValorix grâce à l’aide notamment de Nicolas Pinget, m’intéressait en tant que chercheure. En effet, eValorix repose sur l’idée qu’il est possible de transformer des connaissances en sciences sociales ou en gestion en artefacts visibles, comme des méthodes ou des outils de diagnostic qui leur donnent une plus grande visibilité. Au-delà de l’aspect « valorisation », c’est donc surtout l’aspect « visibilité » qui m’intéressait.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Anne Mesny : Le principal défi c’est la mesure et les indicateurs. Dans mes domaines (la sociologie et la gestion) il est très difficile de « mesurer » l’utilisation ou l’utilité de la connaissance. J’aime bien la métaphore de la traçabilité dans les aliments. On est maintenant capable de remonter du steak emballé à l’épicerie jusqu’à la vache chez l’éleveur. Comment est-on capable de tracer la connaissance issue des sciences sociales – comme par exemple un chercheur qui théorise sur l’échec scolaire – jusqu’au moment où cette théorie inspire une politique publique ou même lorsque des parents utilisent cette connaissance pour s’expliquer certains problèmes de leur enfant à leur école? J’aimerais être capable de tracer la connaissance dans tout ce circuit.
Plus la connaissance issue des sciences sociales est diffusée dans la sphère publique, plus elle fait partie du sens commun, plus on en oublie la source initiale. Le paradoxe fait que plus cette connaissance est utilisée, plus il devient difficile de la tracer ou de la mesurer à l’aide d’indicateurs.
Mesurer l’utilisation des connaissances entre chercheurs, c’est facile – bien qu’il y aurait long à dire sur les indicateurs dont on se sert pour le faire. Cela se corse lorsque l’on tente d’évaluer comment les connaissances sortent du milieu académique ou même parfois si elles en sortent.
Comment vous êtes-vous intéressée à ce sujet?
Anne Mesny : J’ai toujours été très étonnée d’entendre que les sciences sociales sont moins utiles que les sciences de la nature. Lorsque j’écoute des conversations dans le métro ou que je lis un article de journal, je vois des sciences sociales et des connaissances qui circulent! Quand telle théorie néolibérale est (re)passée dans le sens commun (après s’en être nourrie puis détachée!) ou qu’un jeune parle de coût de transactions en se demandant quel est le meilleur moyen de s’acheter sa première auto, c’est majeur! Les notions issues des sciences sociales sont extrêmement utilisées, mais c’est mal documenté et mal compris.
Cette utilisation tous azimut des connaissances issues des sciences sociales peut-être bonne ou mauvaise. Il n’y a rien de forcément positif ou émancipateur dans la mobilisation d’une connaissance. Il n’y a qu’à penser à certaines prophéties autoréalisatrices en économie… Je ne veux pas montrer la beauté de l’utilisation des connaissances issues des sciences sociales, mais plutôt montrer qu’on les utilise tout le temps et que ces utilisations sont porteuses de toutes sortes d’effets, positifs et négatifs… Ces connaissances sont des munitions continuelles dans la réflexion et le discours d’un parent, d’un chef d’État ou d’un chef d’entreprise.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Anne Mesny : J’ai peut-être donné, à tort, l’impression qu’il y a une nette séparation entre les sciences sociales et les sciences de la nature. Cette séparation est toute relative. Beaucoup de phénomènes concernant l’utilisation des connaissances – la transformation en « sens commun », les utilisations conceptuelles ou symboliques, etc. – concernent à la fois les sciences de la nature et les sciences du social.
Il y a un fond commun sur la manière dont les connaissances circulent dans les sociétés. Les technologies, l’internet et les réseaux sociaux, transforment en profondeur les façons de diffuser et d’utiliser ces connaissances. Il reste énormément à étudier là-dessus!
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Laurent Lapierre et la méthode des cas en gestion
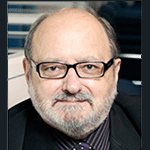 Laurent Lapierre, Ph.D. (McGill), C.M., est professeur honoraire à HEC Montréal. Il a également été directeur général de la Société artistique de l’Université Laval (1968-1970), le premier directeur administratif du Théâtre du Trident (1970-1973), le fondateur du Centre de Cas HEC Montréal et le premier titulaire de la Chaire de leadership Pierre-Péladeau (2001-2013). MBA HEC (1975), il est membre de l’Ordre du Canada depuis 2007.
Laurent Lapierre, Ph.D. (McGill), C.M., est professeur honoraire à HEC Montréal. Il a également été directeur général de la Société artistique de l’Université Laval (1968-1970), le premier directeur administratif du Théâtre du Trident (1970-1973), le fondateur du Centre de Cas HEC Montréal et le premier titulaire de la Chaire de leadership Pierre-Péladeau (2001-2013). MBA HEC (1975), il est membre de l’Ordre du Canada depuis 2007.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Laurent Lapierre : J’ai graduellement compris qu’enseigner la gestion de façon théorique par des cours qui présentent des connaissances ou des modèles normatifs de type ‘’voici comment on devrait faire’’, ne préparent pas vraiment à la pratique de la gestion. C’est intéressant et peut-être rassurant pour les étudiants, mais dans la vraie vie, la gestion ne se passe jamais comme la théorie nous l’a appris. La réalité n’est pas une théorie. La carte n’est pas le territoire. Une carte est utile, voire nécessaire, mais ce n’est jamais le voyage.
Avant de faire mon doctorat, j’ai été le premier directeur du Théâtre du Trident à Québec. Je lisais alors des livres sur « les principes du management », sur comment planifier, organiser, diriger, contrôler… C’était frustrant parce que je savais bien que la gestion au jour-le-jour, c’était plus organique, voire chaotique, et que pour la majorité du temps, là où c’était le plus important ou le plus déterminant, ça ne se passait pas de façon linéaire.
À HEC Montréal, j’ai découvert la méthode des cas qui a longtemps été l’apanage de l’Université Harvard. Plutôt que d’enseigner théoriquement comment on devrait faire, on utilise des histoires de cas. On laisse les étudiants apprendre par eux-mêmes. Idéalement on écrit soi-même les cas dont on a besoin à partir d’entrevues que nous faisons avec de vrais dirigeants. Quand on va en classe, tout le monde a lu cette « histoire », et on vient en classe pour discuter, pour apprendre, pas pour prendre des notes.
Cette pédagogie de type Story Telling fait confiance à l’intelligence des étudiants, à leur désir d’apprendre et de découvrir ce qui peut vraiment leur convenir. L’essence de la gestion, c’est le jugement; et le but de la formation, c’est justement d’affiner leur jugement.
Pour moi, la méthode des cas, c’est ça! Tu t’impliques dans un cours de management, mais il n’y a pas de théories en gestion ou en leadership qui tiennent la route. Si tu étudies les grands dirigeants, tu vas finir par comprendre ce qui a été valable pour eux à leur époque et dans une situation précise, et par te faire une idée de ce qui pourrait être valable pour toi dans une autre situation donnée.
Avant d’arriver dans nos cours, les étudiants ont déjà une bonne idée de ce qu’est la gestion et le leadership. Ils ont déjà beaucoup appris de la vie. Ils savent différencier un leader d’une autre personne qui ne le serait pas par exemple. Les étudiants lisent donc une histoire de cas et ils arrivent prêts pour en discuter en classe. On ne vient pas en classe si on n’a pas lu le cas. C’est d’ailleurs écrit au plan de cours.
Souvent, la discussion commence même avant l’heure du cours. Ils en discutent entre eux au café, par courriels ou dans un forum; ils voient très souvent qu’un autre étudiant n’a pas compris de la même manière qu’eux ou ils découvrent des richesses ou des aspects qu’ils n’avaient pas vus dans cette histoire là. La période du cours n’est que la continuation de cet apprentissage. C’est donc un apprentissage qui se fait principalement par l’étudiant lui-même. Ces séances de formation doivent être passionnantes pour les étudiants.
La plus grande partie du travail du professeur se fait bien avant le cours. Il doit d’abord bâtir un véritable catalogue d’histoires de cas. Pour écrire un cas de 50 pages, ça prend plus de 200 heures. On compte donc 200 heures de préparation pour chaque 75 minutes passées en classe. Mais les étudiants le reconnaissent; ils disent : ‘’enfin, on parle des vraies affaires’’. Une grande partie de la richesse du cours vient de la richesse de ce matériel didactique. L’habileté pédagogique du professeur sert à accoucher ‘‘l’intelligence de gestion’’ de chacun. Il doit rester disponible au happening d’apprentissage qui se passe hic et nunc.
Pendant un cours qui s’échelonne sur un trimestre (28 sessions d’une heure et quart, on peut discuter de 28 histoires de cas différentes. À la fin, les étudiants ont enrichi leur compréhension de ce qu’est la gestion et se découvrent comme gestionnaires en ayant étudié d’autres histoires de cas et en ayant réfléchi sur eux-mêmes.
J’y reviens, la gestion, c’est quelque chose d’organique, de vivant et de chaotique qui évolue tout le temps. Pour moi, la méthode des cas, enrichit l’intelligence et le jugement de l’étudiant. C’est une formation à la pratique qui ne peut pas se faire autrement que par la pratique; celle des autres d’abord et la sienne propre ensuite. La théorie (sous forme de textes d’accompagnement) est enseignée pour mettre l’étudiant en contexte, mais elle est subordonnée parce qu’elle demeure une réduction ou un modèle de la réalité.
Quels sont les défis dans votre champ de recherche?
Laurent Lapierre : Le principal défi pour enseigner par la méthode des cas, c’est d’arrêter d’être un professeur qui enseigne. Tu dois venir en classe en te disant ‘‘ enseigne le moins possible’’. Si tu te mets à enseigner, les étudiants ne vont pas travailler sur le cas, ils ne se rendront pas responsable de leur apprentissage. Ils vont attendre que tu le fasses à leur place.
Pour moi, il faut donc accepter de perdre ‘‘le beau rôle du professeur’’ pour devenir quelqu’un qui fera accoucher les étudiants de leur intelligence, de ce qu’ils sont vraiment, leur faire découvrir ce qu’est la gestion pour eux et les faire réfléchir sur eux-mêmes comme gestionnaires (voir l’entrevue à ce sujet). J’ai la chance que mes cours portent sur le lien entre personnalité et direction.
Il y a différentes façons de gérer et il y a des cas de mauvaise gestion. C’est important que les étudiants voient ça et comprennent ce qu’ils trouvent de mal approprié là-dedans. Ensuite, ça leur permet de décider ce qui sera valable pour eux. Pour enseigner la méthode des cas, il faut que tu arrêtes de penser que c’est toi qui vas enseigner en arrivant avec ta présentation PowerPoint en leur disant ce qu’ils ont à apprendre.
Par exemple, enseigner la médecine de manière seulement théorique, ça ne préparerait pas les médecins à la pratique. Si tu veux de bons médecins, tu dois t’assurer qu’ils aient les connaissances et les techniques nécessaires, mais tu dois leur présenter de vrais problèmes de médecin avec de vrais patients et les préparer résoudre ces problèmes dans la vraie vie. Tu ne travailles pas avec une théorie quand tu travailles avec un patient, tu travailles avec une personne. Alors, les enseignants leur présentent des problèmes de personne et là, la théorie devient intéressante : tu peux t’en servir, mais c’est la personne qui compte.
C’est la même chose pour la gestion. Qu’a fait tel gestionnaire pour telle entreprise, petite ou grande? Il a pris telles décisions et il a posé tels gestes. Qu’en pensez-vous? Et là tu apprends en te disant ‘’OK, je crois avoir compris pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n’a pas marché’’. Et ce n’est jamais final. La pratique de la gestion n’est pas une science. Et le doute existe toujours.
Tout n’est pas que beau dans une entreprise. La réalité est changeante, souvent inquiétante… Il faut apprendre à composer avec cette réalité, et on espère que les dirigeants sont à l’aise, voire qu’ils aiment œuvrer dans ces contextes. On enseigne très souvent en gestion que ça devrait être planifié et organisé. C’est souvent impossible.
Sans oublier que tu ne gères pas qu’avec des qualités personnelles. Je pense qu’on gère autant avec ses défauts personnels qu’avec ses qualités. Personne n’ose parler des défauts. Si tu as des défauts personnels, tu ne les perds pas en devenant gestionnaire. Tu peux être autoritaire ou impatient, par exemple, mais il faut que tu apprennes à composer avec ces défauts, et surtout à t’en prémunir.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Laurent Lapierre : J’ai commencé ma carrière de gestionnaire comme directeur général de la société artistique à l’Université Laval. Je connaissais pas par expérience ce qu’était cette responsabilité. Ce sont d’autres personnes qui ont jugé que je pourrais faire ce travail. De cette expérience, je suis resté persuadé que le casting est fondamental et que, très souvent, il ne peut pas être fait par la personne elle-même.
Je suis arrivé dans ce poste et j’ai été obligé d’inventer. Plus tard, j’ai été le premier directeur au Théâtre du Trident. D’autres personnes me voyaient dans ce travail que je ne connaissais aucunement. J’avais bien étudié au Conservatoire d’art dramatique, mais je n’avais jamais fait de gestion de théâtre. J’ai été obligé d’inventer ma méthode. Je suis venu rencontrer trois directeurs de théâtre que je connaissais. Je leur ai demandé de me consacrer une journée chacun et je les ai écoutés. Un peu comme si je prenais leur cas pour savoir comment je devais faire. Je leur ai dit : ‘’racontez-moi’’. Ce fut mon cours gestion ça.
Je n’ai pas eu d’autres cours de gestion à ce moment-là. Tu n’as pas le choix d’être ton propre mentor, parce qu’il n’y en a pas d’autres. Tu es seul à faire la job, mais tu ne l’as jamais faite et tu n’as pas étudié ce domaine. Tu n’es donc pas contaminé par les études ni par les théories des autres. Tu peux écouter, lire, étudier, mais tu es donc obligé de trouver ta propre façon pour gérer. C’est ça que j’ai découvert plus tard avec la méthode des cas aux HEC. Tu acquiers le goût d’écouter les autres, autant ceux qui dirigent que ceux qui sont dirigés.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Laurent Lapierre : Pour arriver à vouloir faire de la formation en utilisant la méthode des cas, je pense qu’il faut éprouver une insatisfaction à enseigner la gestion de façon traditionnelle. Ton insatisfaction devient ton véritable moteur. Qu’est-ce qui fait que tu trouves que tes étudiants ne sont pas intéressés ou que ça ne donne pas les résultats que tu veux ? C’est à partir de cette insatisfaction que tu vas vouloir te construire une autre méthode.
Bien sûr, je suis allé à l’école et je m’étais ennuyé jeune. J’ai fait de l’enseignement plus tard et je me suis dit : ‘’il faut que mes élèves aiment ça venir à l’école, il faut qu’ils aiment et qu’ils veillent apprendre ’’. J’ai donc inventé une méthode, inspirée de Célestin Freinet, un grand pédagogue français, parce que je voulais que les élèves sortent à 16 h et se disent qu’ils avaient passé une bonne journée et qu’ils avaient appris de façon intéressante.
Si un jeune professeur n’éprouve aucun malaise à enseigner de façon magistrale ou traditionnelle, s’il pense que c’est ça la bonne façon, je lui dirais de continuer à faire ce qu’il fait. J’ai tellement vu d’utilisation de la méthode des cas qui n’était que de l’enseignement magistral déguisé ! C’est pis que la véritable méthode des cas.
S’il a un malaise cependant, je lui dirais de travailler sur ce malaise pour trouver une façon qui soit plus intéressante pour lui et ses étudiants, et qui leur permettrait d’apprendre mieux, plus vite ou de façon plus solide. Bâtis là-dessus. Essaie de te trouver.
On n’est jamais aussi intéressant qu’on voudrait être, même avec la méthode des cas. Il y a des fois que ça marche de façon extraordinaire, alors qu’à d’autres moments ça ne marche pas, ça ne lève pas. Ça n’arrive pas par magie. La méthode des cas est elle-même un apprentissage très long. Il d’abord désapprendre parce que le système scolaire est basé sur l’enseignement. Il faut apprendre à travailler sur les difficultés de ce métier-là et à aimer ces difficultés qui deviennent des défis.
Je crois que c’est Freud qui a dit qu’il y avait trois métiers impossibles : gouverner, psychanalyser et enseigner. Enseigner est un de ces métiers impossibles. Si tu ne fais que transmettre des connaissances, ça va. Tu fais passer un examen à la fin, et tu mesures si ces connaissances sont sues. Est-ce que les étudiants ont retenu les connaissances que tu leur as transmises en classe? Et ça se mesure !
Ce qu’on enseigne en gestion, c’est une pratique. Avoir des connaissances ne suffit pas. Quand j’ai étudié au Conservatoire d’art dramatique, on ne nous disait pas ‘’voici ce qu’a écrit tel grand acteur ou théoricien du théâtre. Va apprendre ça’’. Non, on nous disait ‘‘on s’en fout des théories, monte sur scène et joue, soit vrai”. En gestion, c’est pareil. Tu as beau avoir lu toutes les théories, si tu ne sais pas ce que c’est de travailler avec des gens pour obtenir des résultats, tu n’y arriveras pas.
P.S. J’ai été chanceux d’étudier au Conservatoire d’art dramatique, en pédagogie, d’avoir été enseignant au primaire et d’avoir été jeté dans la fosse aux lions de la gestion.
Laurent Lapierre chez eValorix
Texte par Kassandra Martel
Propos recueillis par Félix Vaillancourt
Marc-Antonin Hennebert, les relations de travail et le syndicalisme
 Marc-Antonin Hennebert est professeur agrégé au Département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal. Il est également membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT)
Marc-Antonin Hennebert est professeur agrégé au Département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal. Il est également membre du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT)
Expertises
Relations de travail, syndicalisme, négociation collective, firmes multinationales et responsabilité sociale.
À quel besoin souhaitez-vous répondre avec votre recherche?
Marc-Antonin Hennebert : Mon domaine de recherche est celui des relations de travail et du syndicalisme. À HEC, il fait partie de la sphère plus large de la gestion des ressources humaines (GRH). À ce titre, deux projets de recherche concernant le monde syndical m’ont plus particulièrement occupé au cours des dernières années.
Le premier, de nature plus internationale, concerne la montée en nombre et en puissance des entreprises multinationales et l’implication de ce phénomène sur la régulation du travail. La question au cœur de ce projet est de savoir comment les travailleurs et leurs représentants peuvent s’assurer du respect des droits sociaux fondamentaux des employés au sein des multinationales, mais aussi au sein de leurs réseaux de sous-traitants et de leurs chaînes de valeur? À cet égard, certaines organisations syndicales ont innové au cours des dernières années en développant de nouvelles pratiques de concertation intersyndicale au plan international et en construisant des coalitions et des alliances plus ou moins formelles selon les cas. Ces alliances regroupent généralement des syndicats qui représentent les travailleurs d’une même multinationale dans ses différents établissements à travers le monde et cherche d’ordinaire à ouvrir un dialogue avec la direction de ces entreprises pour assurer un meilleur respect des droits des travailleurs notamment dans les pays où les structures institutionnelles en matière de travail sont déficientes. Ce thème de recherche se veut très proche de celui de la responsabilité sociale des entreprises, mais vu sous l’angle syndical.
Dans un contexte de transformations des milieux de travail, mon deuxième projet de recherche s’intéresse à la réalité des représentants syndicaux au sein des entreprises et à la problématique du renouvellement du leadership de ces représentants. En effet, la complexification observée du travail de ces représentants, et notamment des présidents de syndicats locaux auquel ce projet s’intéresse de manière particulière, les placent aujourd’hui devant de nombreux défis et soulève des questions quant aux meilleures pratiques en matière de représentation syndicale. Ce projet de recherche vise un objectif fondamental, soit celui d’identifier, selon notamment certains contextes sectoriels déterminés, comment les représentants syndicaux composent avec de tels défis et comment certains parviennent à devenir des acteurs stratégiques à la fois au sein de leur syndicat et de leur entreprise.
Quels sont les principaux défis dans votre champ de recherche?
Marc-Antonin Hennebert : Les organisations syndicales avec lesquelles je travaille depuis plusieurs années sont confrontées à de multiples défis provenant à la fois de leur environnement externe et interne. Dans le premier cas, je pense notamment à la mondialisation, aux recompositions sectorielles (les emplois se développent aujourd’hui surtout dans des secteurs moins syndiqués), aux besoins nouveaux des employeurs (réductions de coûts, flexibilité dans l’organisation et les conditions de travail), etc. Concernant l’environnement interne, les membres des syndicats ont également des besoins nouveaux notamment en matière de conciliation travail-famille et leurs intérêts sont plus diversifiés qu’auparavant. Les organisations syndicales, comme les entreprises, sont donc aujourd’hui condamnées à revoir leurs pratiques pour s’ajuster à leur nouvel environnement.
En outre, dans un contexte où les ressources humaines se positionnent de plus en plus comme une source d’avantage compétitif, les relations de travail peuvent venir jouer un rôle plus important dans la définition de la compétitivité des entreprises. Cela place les acteurs syndicaux dans une position où ils peuvent potentiellement jouer un rôle de partenaire stratégique au sein de leur organisation. Dans ce contexte, je me pose certaines questions de portée générale : Quelle est l’état actuel des relations de travail dans nos entreprises au Québec? Quelles sont les défis inhérents à une saine gestion des relations de travail? Quelles sont les meilleures pratiques relativement à l’implication des syndicats au sein des processus de changement des entreprises ?
Au fil de nos recherches, nous avons toujours eu un accueil très positif des entreprises et des organisations syndicales impliquées dans nos projets. Nous cherchons aussi à avoir des conclusions pratiques qui peuvent offrir autant d’outils réflexifs à nos partenaires de recherche et les guider dans leurs pratiques.
Comment vous êtes-vous intéressé à ce sujet?
Marc-Antonin Hennebert : Alors que j’étais étudiant en gestion, je me suis rendu compte qu’on étudiait beaucoup les organisations du point de vue de ses dirigeants et de ses principales sphères de pouvoir. Toutefois l’entreprise est un lieu pluriel où s’entremêlent intérêts et groupes divers. Évidemment, il est fondamental d’étudier la réalité des gestionnaires pour comprendre les organisations, mais je trouvais néanmoins qu’on ne s’intéressait pas assez aux formes de contre-pouvoirs au sein des organisations dans lesquels les syndicats jouent un rôle assez important. Mes premières recherches m’ont démontré que, parfois dans une même entreprise, les dirigeants et gestionnaires, d’une part, et les représentants syndicaux et les travailleurs, d’autre part, ont parfois une vision très différente de leur réalité organisationnelle.
L’étude des relations de travail et du syndicalisme est donc pour moi une manière importante de contribuer à la compréhension de nos univers organisationnels. Elles permettent notamment d’exposer le point de vue des travailleurs et de leurs représentants, soit un peu l’envers de la médaille.
Que diriez-vous à quelqu’un qui débute dans votre domaine?
Marc-Antonin Hennebert : J’ai récemment écrit un texte dans la revue de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (ORHRI) qui témoigne un peu de ma vision des relations de travail en entreprise et des conseils que je donnerais aux gestionnaires dans ce domaine (pour consulter le texte intégral en étant membre de l’Ordre suivre ce lien HENNEBERT, Marc-Antonin. 2014. « Entre les méandres de la conflictualité et l’idéal collaboratif : gérer ses relations de travail de manière réaliste ! ». Effectif, revue de l’Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, vol. 17, no. 2, p. 14-19. )
Il est tout d’abord important de reconnaître la pluralité des intérêts dans les organisations. La formation des étudiants au sein des écoles de gestion peut parfois donner une vision unitaire des organisations masquant les intérêts potentiellement différents de certains groupes. Comprendre la diversité des intérêts au sein des organisations est pour moi fondamental!
Il me semble également important pour tout gestionnaire RH de saisir la responsabilité et les contraintes des représentants syndicaux et pallier au manque de connaissances des autres gestionnaires en cette matière. Les relations de travail sont encadrées par un régime juridique (notamment le code du travail) qui crée des obligations de toutes sortes dont celle pour les représentants syndicaux de s’assurer de défendre leurs membres de manière juste et équitable. La réalité est la même du côté des gestionnaires : il existe une obligation de négocier de bonne foi le renouvellement des conventions collectives, de reconnaître et de ne pas entraver les activités syndicales, de respecter la procédure de grief, etc. Il est donc impératif de connaitre ses responsabilités et ses obligations légales.
Il faut aussi accepter, comme gestionnaire RH, les désaccords potentiels avec les syndicats et même l’impossibilité de s’entendre sur certains enjeux, tout en cherchant à minimiser les impacts à long terme sur les relations patronales-syndicales. Fonctionner par consensus est un idéal qui n’est pas toujours à l’épreuve de la réalité. Le défi pour un gestionnaire en relations de travail n’est pas d’éviter à tout prix les désaccords, mais de chercher à minimiser leurs effets sur les relations entre les parties à plus long terme.
Finalement, il ne faut pas avoir peur d’innover et de remettre en cause les pratiques dans le domaine des relations de travail. Le monde des relations de travail en est un au demeurant assez conservateur dans la mesure où les pratiques et façons de faire se sont instituées au fil des années (négociations collectives, procédure de grief, etc.) et qu’elles évoluent plus lentement que dans d’autres domaines. Il ne faut pas avoir peur d’innover, de remettre en cause certaines pratiques. À titre d’exemple, on observe aujourd’hui dans certaines entreprises le désir d’établir une culture du dialogue plus soutenue entre les parties par l’intermédiaire de la création de comités de négociation continue visant à faire évoluer les conditions de travail entre les périodes plus formelles de renouvellement de la convention collective. Des syndicats jouent aussi un rôle plus important dans les sphères décisionnelles des entreprises ce qui apparaît comme une avenue intéressante, même si elle représente un défi important pour les parties, pour le renouvellement de nos relations de travail.
Marc-Antonin Hennebert chez eValorix
Propos recueillis par Félix Vaillancourt.
À la découverte de HEC Montréal : les études de cas et les articles de gestion
Depuis 1907, HEC Montréal forme la relève en gestion qui contribue à l’essor de la société. Partenaire d’eValorix de la première heure, HEC Montréal a grandement contribué à la création d’eValorix et a désormais sa propre page institutionnelle : Découvrez la page HEC Montréal
Centre de cas, « développer le savoir, savoir-faire et savoir-être des étudiants, gestionnaires et dirigeants »
Depuis plus de 40 ans, le Centre de cas HEC Montréal cherche à promouvoir l’enseignement de la gestion par les cas. Outil de formation et d’apprentissage stimulant, le cas pédagogique vise, à travers une situation réelle d’entreprise ou de secteur industriel, à développer non seulement le savoir des étudiants, mais surtout le savoir-faire et le savoir-être de gestionnaires et de dirigeants (en savoir plus sur l’étude de cas ici). eValorix propose plus de 650 cas du Centre de cas (chiffre au 19 mai 2016) dans différents domaines, de la stratégie à la comptabilité en passant par les technologies de l’information, le marketing, la gestion des ressources humaines, la comptabilité ou encore la gestion des opérations et de la logistique.
Revue Gestion, « s’informer sur la gestion d’entreprise, le management et l’entrepreneuriat »
En 1976, HEC Montréal a également créé la revue Gestion, le premier magazine nord-américain francophone destiné aux acteurs du monde des affaires. Dans ce magazine figurent des articles experts, accessibles et créatifs pour s’informer sur la gestion d’entreprise, le management et l’entrepreneuriat. eValorix vend une dizaine de cahiers de la revue Gestion. Ces cahiers regroupent plusieurs articles sur une même problématique dans un contexte de gestion telle que la gestion de la rémunération ou encore le droit du travail (en savoir plus sur ces cahiers).
Découvrez HEC Montréal et ses outils

